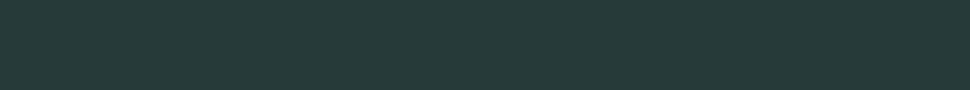La résilience des entreprises : une leçon inspirée par Kant

Depuis 2008, les entreprises européennes ont fait face à une série inédite de crises, allant de la finance à la santé, en passant par l’énergie et le climat. Cette succession imprévisible de « cygnes noirs »[1] a été associée à l’incertitude liée aux « cygnes verts et bruns », menaçant les initiatives de réindustrialisation, d’encadrement de l’Intelligence Artificielle et de transition énergétique. Malgré ces défis, cette période a renforcé l’antifragilité des entreprises, stimulant leur réactivité et leur capacité d’adaptation, notamment grâce à de nouvelles perspectives temporelles et spatiales inspirées par Kant[2].
Leurs perceptions de l’espace ont été en effet affinées par de nouvelles approches des systèmes productifs et des supply chains, de la relocalisation des écosystèmes industriels et de la diversification des services en ligne. Dans le temps, les entrepreneurs et les managers ont dû faire face à une croissance économique suspendue par la crise pandémique puis à une hausse brutale des prix des matières premières, de l’énergie et des produits alimentaires. Les acteurs de l’entreprise se sont pour la plupart adaptés à des temporalités contradictoires. Face à cette « confusion entre horizons », ils se sont efforcés de concilier performance à court terme et soutenabilité à long terme. La recherche de profit immédiat et la gouvernance actionnariale des entreprises rivalisent désormais avec des objectifs intergénérationnels de performances extra-financières et une gouvernance plus partenariale.
[1] Nissim Taleb, Le cygne noir, la puissance de l’imprévisible, Les Belles Lettres, 2012.
[2] Emmanuel Kant, Critique de la raison pure, PUF, 1787.
Découvrez d'autres articles