Des performances financières aux performances globales : les nouvelles approches du risque
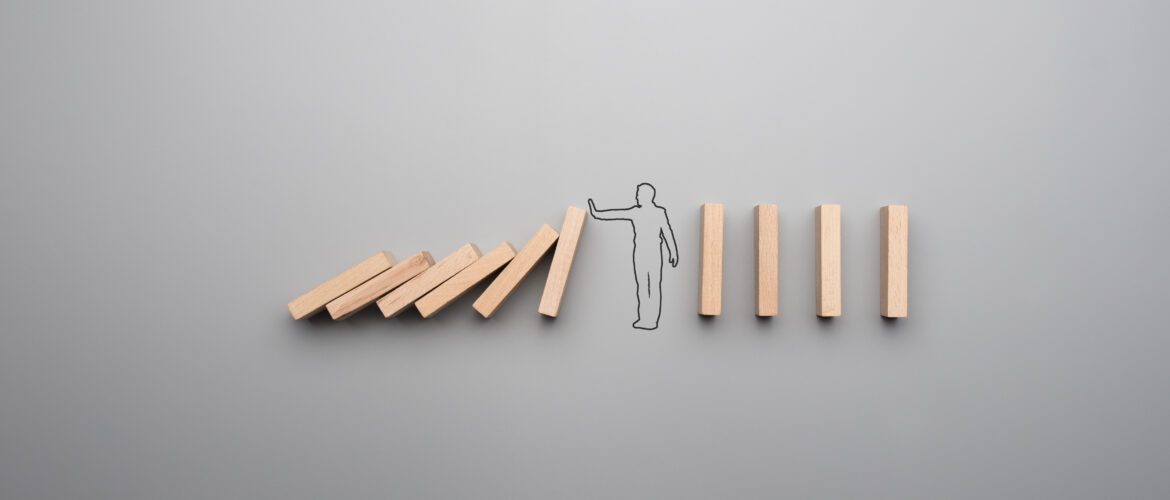
Le management des entreprises est fondé sur les notions de performance et de risque. Mais ces deux notions sont polysémiques et contingentes. Leurs définitions diffèrent dans l’espace et évoluent dans le temps. Elles varient selon les disciplines (stratégique, financière, sociale, sociétale, environnementale…) et selon les types d’activité. Elles sont également influencées par les paradigmes qui dominent chaque époque. La suprématie de la technostructure managériale, dénoncée par Galbraith au cours des années 1960 et 1970, a laissé place à celle des actionnaires, théorisée par Friedman à partir des années 1980, puis à celle des parties prenantes, initiée par Freeman à partir des années 1990. Aux notions de performances économique et financière, ont succédé celle de performances ESG (Environnementale, Sociale et de Gouvernance). Un des questionnements actuellement partagés par les métiers du chiffre – internes et externes à l’entreprise – porte sur les enjeux et les modalités d’une intégration des performances financières et extra-financières. Mais cette démarche implique la construction de nouveaux modèles, leur validation par les praticiens et leur légitimation par de nouveaux référentiels.
Les indicateurs de performances
Le pilotage des performances d’une organisation repose sur des indicateurs (ou des proxies) de nature comptable et économique, qui visent notamment à mesurer la capacité de l’entreprise à rentabiliser durablement ses actifs. Depuis un demi-siècle, la capacité prédictive (ou value relevance) de ces indicateurs a fait l’objet de nombreuses recherches qui ont identifié le résultat net, le résultat d’exploitation, le résultat pro forma, le résultat global [1] , l’Excédent Brut d’Exploitation, l’EBITDA [2] et le free cash flow [3], comme étant les indicateurs les plus cités dans les rapports de gestion des entreprises. Il semble que parmi ces indicateurs, le résultat net et le free cash flow soient les mieux corrélés aux variations des cours boursiers des sociétés.
Au cours des années 1980, sous l’influence des cabinets d’audit anglo-saxons, l’analyse des performances des entreprises a été marquée par le passage d’une approche managériale à une approche actionnariale. Les modèles de projection du discounted cash flow ou des EVA [4] actualisées se sont rapidement imposés pour calculer les valeurs des capitaux propres et orienter les cours boursiers des entreprises. Ces modèles permettent de distinguer les leviers de la performance financière, de nature soit endogène (liés à la qualité du management) et exogène (dépendant du marché, du coût de la dette et du taux d’imposition). Ils ont fait l’objet de critiques croissantes en raison de leur finalité essentiellement financière et de leur sous-estimation des risques sociaux et environnementaux encourus par les entreprises.
A partir des année 2010 – et notamment, de la « directive RSE » de 2014 – la Commission européenne a énoncé des principes visant à rendre les informations financières et extra-financières des entreprises à la fois plus « adaptées, soutenables, comparables, fiables, compréhensibles et vérifiables ». Les données doivent « renseigner le processus de création de valeur de l’entreprise et préciser le mode de répartition de cette valeur entre ses partes prenantes ». Elles doivent présenter les enjeux sociaux et environnementaux – en termes à la fois d’opportunités et de risques – qui sont attachés aux activités et aux projets de l’entreprise. Les indicateurs statistiques doivent être cohérents avec les indicateurs comptables du rapport de gestion de l’entreprise. Les rapports extra-financiers doivent couvrir trois facteurs (la stratégie et le modèle d’affaires de l’entreprise, les modalités de leur mise œuvre et la mesure de leurs effets), ainsi que les trois thématiques ESG (environnementale, sociale et sociétale, de la gouvernance). Les batteries-types d’indicateurs doivent respecter les principaux référentiels internationaux : ISO 26000, GRI (Global Reporting Initiative) et TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosure ).
La construction de certains indicateurs font appel à la méthode CARE (Comprehensive Accounting in Respect of Ecology), qui s’inspire des travaux de Gary Becker sur le capital humain, afin de proposer une nouvelle comptabilisation du capital naturel, considéré comme une ressource amortissable et une dette remboursable aux parties prenantes de l’entreprise. Elle s’inscrit dans le courant de la « comptabilité universelle » (ou « comptabilité verte »), qui vise à mesurer par des indicateurs comptables les effets des activités de l’entreprise.
D’autres modèles visent à piloter la « performance globale » de l’entreprise. Ils s’inspirent notamment du Sustainable Balanced Scorecard (SBSC), qui intègre des indicateurs de performances économique, sociale, sociétale et environnementale, ainsi que de l’approche du Total Responsability Management, qui mesure par la performance globale, la capacité de l’entreprise à intégrer durablement les approches du Développement Durable et de la RSE à ses processus managériaux.
La mesure du risque
Cette évolution de la notion de performance de l’entreprise s’est accompagnée d’une mutation de l’approche du risque, qui a initialement reposé sur des diagnostics stratégiques et financiers faisant principalement appel à des méthodes de scoring centrées sur le risque de crédit bancaire et le risque de défaillance de l’entreprise. Ces derniers sont alors détectés par des analyses discriminantes et des régressions logit (comme le modèle d’Ohlson). Afin d’améliorer la capacité prédictive de ces modèles, des recherches se sont orientées vers des analyses basées sur les causes plutôt que sur les conséquences des risques. Elles ont traité des données événementielles plutôt que financières et appliqué des techniques d’analyse de survie (hazard model), des calculs de probabilité de faillite à différentes étapes du cycle de l’entreprise, des formules d’évaluation des options financières ou de simulation par des réseaux neuronaux.
A partir des années 1980, marquées par une gouvernance dominée par les actionnaires, les risques pesant sur les performances et la valeur de l’entreprise ont fait l’objet d’approches visant à projeter la rentabilité prévisionnelle des capitaux propres (comme le modèle CAPM) et à actualiser les flux en fonction du coût moyen de financement des actifs (ou coût moyen pondéré du capital). Dans ces formules, le rapport statistique entre le risque systématique lié au marché et le risque spécifique lié la gestion de l’entreprise, est mesuré par un coefficient beta calculé à partir des volatilités des cours boursiers.
Ces modèles ne distinguent toutefois ni les natures, ni les causes et les effets des risques engendrés par les différentes activités de l’entreprise. C’est pourquoi, depuis les années 2010, des recherches visent à mieux spécifier ces risques, mesurer leurs enjeux et valoriser les impacts positifs et négatifs des activités dans le temps et dans l’espace. Certains impacts auprès des parties prenantes internes et externes à l’entreprise peuvent comporter des risques notamment commerciaux, organisationnels et juridiques, dont les plus graves peuvent menacer la survie même de l’entreprise. La mesure du risque global engendré par la non-conformité aux critères ESG implique le traitement de données fragmentées ou sectorielles (conformément à la norme IFRS 8), portant sur les impacts directs et indirects de l’activité opérationnelle de l’entreprise dans chacun de ses secteurs. Les émissions de carbone doivent ainsi être classées en émissions directes (scope 1) et indirectes (scopes 2 et 3) ; elles doivent faire l’objet d’un bilan carbone et d’un profil GES (Gaz à Effet de Serre).
Les évaluations des risques sanitaires et sociaux, des risques sociétaux (sécurité des usagers, menaces sur l’emploi local…) et des risques environnementaux (émission de carbone, atteintes à la bio-diversité, pollutions diverses …) doivent s’inscrire dans des processus de hiérarchisation des parties prenantes, de délimitation des périmètres d’impacts, d’analyse des chaînes d’impacts et de valorisation de ces derniers par des méthodes scientifiques validées. Elles doivent appliquer des logiques socio-économiques et des modèles de valorisation plus robustes que les appréciations qualitatives et les énoncés performatifs – parfois empreints de social et/ou de green washing – recensés dans certains discours et rapports extra-financiers.
D’autres recherches, menées notamment par des gestionnaires d’actifs, testent l’application de modèles financiers pour évaluer les risques globaux. Le coefficient beta est ainsi complété par le coefficient alpha qui compare la performance boursière d’un titre de société (ou d’un portefeuille d’investissements) à celle d’un indice de référence composé d’actions best-in-class suivant les critères ESG. Une sous-performance ESG durable (alpha inférieur à 1) est un indicateur de risque global qui influence de plus en plus les transactions des investisseurs.
Bien que lapidaires, ces réflexions montrent l’importance et la complexité des mutations en cours des indicateurs de performance et de risque des entreprises.
[1] Le résultat global (comprehensive income) comprend le résultat net comptable et les variations non monétaires des capitaux propres.
[2] Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) désigne le bénéfice d’une société avant intérêts, impôts sur les sociétés, dotations aux amortissements et aux provisions.
[3] Le free cash flow recouvre le flux de trésorerie issu de l’exploitation après déduction des investissements de maintien.
[4] La Valeur Economique Ajoutée (Economic Value Added) est égal à la différence entre le résultat d’exploitation après impôts et la rémunération au coût moyen pondéré du capital des capitaux propres et des dette à long terme de l’entreprise (modèle conçu par le cabinet Stewart-Stern)..
(version du 11 septembre 2022)







