Les principes d’un bon impôt (Partie 1) : lecture de « Impôts – Le grand désordre » de Vivien Levy-Garboua et Gérard Maarek
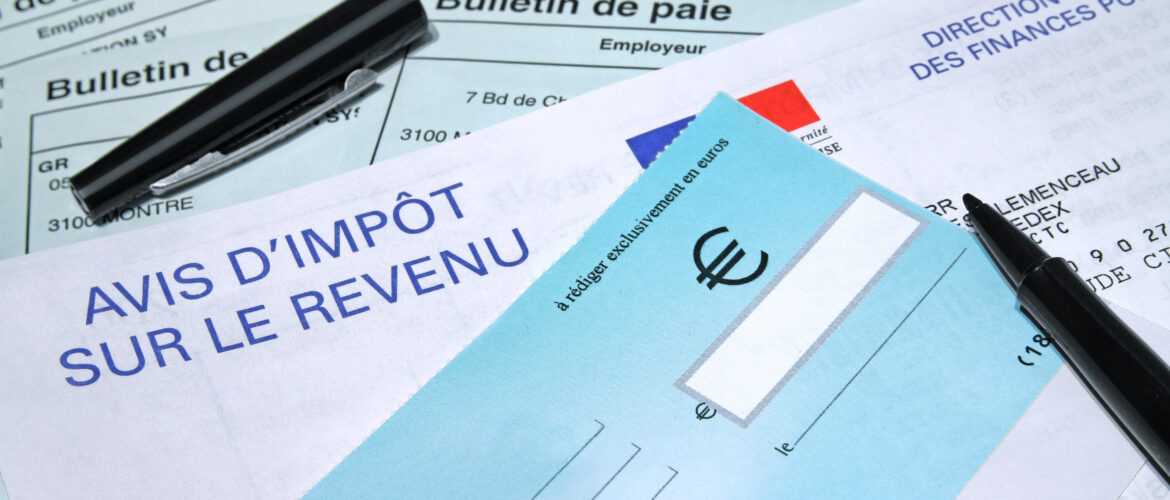
Voici un livre à lire. Point. J’imagine tout lecteur un tant soit peu intéressé par la matière fiscale faire comme moi, prendre son crayon pour annoter fébrilement le livre. Ceci avec des plus et des moins, c’est-à-dire en étant d’accord ou pas d’accord, chose souvent plus féconde pour la réflexion que de simplement constater son accord avec les mots que l’auteur a su trouver.
Pour la seconde partie de cet article : cliquer ici
Un gros avantage du livre est que les deux auteurs, notés LGM ci-après, ont beaucoup lu. Ils ont pesé le pour et le contre des arguments exposés. S’ils sont clairement dans le camp des « moins d’impôts », leur livre repose sur les travaux des meilleurs économistes sur le sujet, y compris un Piketty ou un Saez à l’occasion, et ceci, toujours à leur crédit, en présentant leurs arguments (presque) toujours dans des termes accessibles à un large public. Ils évitent aussi le syndrome de la « Grande Réforme fiscale » de type page blanche, exercice souvent d’une grande vacuité. En effet, la fiscalité est complexe, comme l’est la vie économique, de sorte qu’il vaut mieux se limiter à mettre en avant les principes que devraient observer un « bon impôt », une tâche déjà suffisamment ambitieuse. Les auteurs retiennent aussi de leur expérience d’économistes cette bonne habitude de la « vision large », prenant en compte les effets directs mais aussi indirects d’une mesure fiscale. Par exemple, supprimer ou réduire un impôt oblige à supprimer une dépense ou à accroître un autre impôt ou à s’endetter. On ne peut juger du bien-fondé d’un impôt qu’au sein d’un ensemble d’impôts qui lui sont ou non préférables.
Dans la même lignée, ils expliquent très bien la notion-clé d’« incidence fiscale » : un impôt n’est jamais intégralement assumé par celui qui le paie. Si l’on prend l’exemple des cotisations sociales, est-ce le salarié ou l’entreprise qui les prend en charge ? Chacun un bout, dit le code des impôts et contributions. Mais on voit bien que si l’entreprise a la main haute dans la fixation du salaire, la hausse du taux de cotisation partira à terme en baisse des salaires ; dans le cas inverse (on songe aux cadres supérieurs expatriés), c’est clairement l’entreprise qui en assume le coût. Le raisonnement ne s’arrête pas là : si l’entreprise peut répercuter sur ses employés le coût des cotisations, elle préserve sa compétitivité prix et pourra peut-être davantage embaucher. Si elle peut faire passer cette hausse dans ses prix, ce sont ses clients qui paieront en quelque sorte la taxe. Ceci à l’infini, de sorte qu’on ne peut échapper à un calcul d’ensemble pour juger du bien-fondé d’une taxe, à la fois pour le budget public, et pour tel ou tel agent. Et comme ce calcul est impossible à faire avec les instruments dont disposent aujourd’hui les économistes, il est probable qu’on ira longtemps encore polémiquer (y compris intelligemment) sur la chose fiscale.
Il y a de bons chapitres sur le thème lié des « dépenses fiscales », c’est-à-dire des cas où tel bien ou tel comportement est non pas pénalisé mais subventionné par le jeu de l’impôt. Après cette lecture, on n’a plus à s’interroger sur l’efficacité du Crédit impôt recherche (CIR) et de la jungle des aides au logement. Elle est nulle. On aurait aimé que les auteurs s’interrogent aussi sur la niche fiscale qu’est l’aide fiscale à la participation et l’intéressement, où la France tient le record mondial du subventionnement.
Cette incidence toujours indirecte de l’impôt fait qu’on doit s’attacher prioritairement à mesurer quelle sera la réaction du contribuable à une variation du taux de l’impôt. Nous entrons là dans ce qu’on peut appeler le « dilemme de l’élasticité » qu’on peut illustrer par le cas de la fiscalité sur le tabac. Si le contribuable réagit à une hausse de taxe par la fuite (l’« exit »), il baissera sa consommation ou achètera des cigarettes en parallèle. Il y aurait une forte élasticité de la demande (officielle) et une collecte fiscale faible (ce devrait être l’objectif ultime des taxes comportementales : ne rien rapporter, ayant rempli pleinement leur rôle). Mais si la demande reste rigide (élasticité faible), alors l’impôt rapporte beaucoup, mais la personne ou le ménage subissent une baisse de pouvoir d’achat, d’où leurs protestations (le « voice »). Dans leur détestation pathologique de l’impôt (ce qui n’est pas le cas de LGM), certains économistes jouent sur les deux tableaux : critiquer l’impôt parce qu’il porte atteinte à la liberté de consommer si l’élasticité est forte ; le critiquer encore si elle est faible, comme à l’occasion de la révolte des Gilets jaunes devant une hausse des carburants à laquelle ils ne pouvaient échapper.
À signaler aussi le bon chapitre sur la fiscalité dans un contexte international, avec les discussions sur l’optimisation ou l’évasion (c’est-à-dire la fraude) fiscales.
La position de LGM, « moins d’impôts » tient avant tout à ce qu’ils sont du camp des « moins de dépenses ». Ils notent que beaucoup des biens dits publics qu’assume aujourd’hui l’État (la santé et l’éducation au premier chef) sont des biens dits supérieurs, pour lesquels il n’y a pas, dans l’état actuel de la technologie, de progrès marquants de productivité du travail : il faut toujours x profs par élève ou y infirmières par malade hospitalisé, de sorte que le coût de ce type de service ira inéluctablement en croissant. Si l’on pense que l’État doit prendre en charge ces services plutôt que le privé, il faut en accepter la conséquence qui est que la part de l’État dans l’économie ne fera que croître, sauf à ce qu’il se dégage d’autres activités où son intervention directe est moins légitime ou impérative. LGM opte plutôt pour un modèle mixte, notamment pour l’éducation ou la santé, où l’État et des acteurs privés se partagent les rôles. On y vient dans une minute.
Mes réserves
Les notes que j’ai griffonnées en marge du livre ne sont pas toutes positives, mais me voici prêt au dialogue. Le premier point concerne les impôts à taux fixe ou variable portant sur le stock de capital (IK par la suite). Il y a une longue tradition d’économistes, dont Walras et Allais, ceci bien avant les Piketty et Saez, qui militent pour la mise en place d’un impôt large sur le capital, ce que n’a pas été l’ISF français, mité de toute part. Sans doute parce que l’un des auteurs a été l’élève de Allais à l’École des Mines, il y a un fort plaidoyer dans le livre pour un tel impôt[1]. Celui-ci pourrait, note LGM sans se cacher les difficultés pratiques (p. 106), remplacer toute la batterie des impôts qui pèsent sur le capital, dont l’IS, l’IR sur les dividendes et les intérêts, la taxe foncière, les impôts sur la production, etc., ceci en observant qu’un impôt sur le revenu du capital est aussi un impôt sur le capital. (On réserve ci-après l’acronyme IK au seul impôt frappant le stock même de capital.)
Là où on suit moins facilement les auteurs, c’est quand ils recommandent de regrouper les différents impôts sur le capital au sein d’un unique IK, sans craindre d’ailleurs de noter que cet IK risque alors de devenir « trop » élevé et qu’il va freiner l’accumulation du capital[2].
Si le coût du capital s’accroît de 35% du fait des divers impôts qui le frappent (chiffre auquel arrive LGM en rapportant à la valeur du capital l’addition de toutes les taxes qui s’y rapportent), on utiliserait en effet 35% de moins de capital relativement au travail[3]. D’où une baisse considérable de l’investissement. Mais ceci ne vaut que si, contrairement au conseil de LGM, on oublie de faire le bouclage : avec ces 35% de recettes fiscales l’État contribue peut-être lui aussi à accumuler du capital, par exemple d’infrastructure. De plus, point technique plus délicat, il y a aussi des taxes sur le travail qui contribuent à réduire le coût relatif du capital au travail et par conséquent à réduire ou supprimer l’effet négatif mentionné[4].
Si l’engouement des auteurs pour l’IK reste très partiel, il les conduit à préconiser une suppression de l’IS. Or, l’IS est un excellent complément de l’IK et réciproquement. Prenons le cas d’un IS qui prend un tiers du profit de l’entreprise et un tiers des pertes[5] et d’un IK qui s’élève à 2% du stock de capital. Si la rentabilité nette moyenne du capital est de 6%, on voit que les deux impôts rapportent en moyenne la même chose. Mais il y a une grande différence, insuffisamment perçue par LGM : dans le cas de IK, l’actionnaire ramasse toute la profitabilité au-dessus de 2% ; dans le cas de l’IS, il est obligé de partager son gain, si haut soit-il, dans la proportion un tiers / deux-tiers. L’État est en quelque sorte dans la situation d’un créancier dans le cas de l’IK et d’un quasi-actionnaire dans le cas de l’IS et l’on retrouve les propriétés incitatives respectives de la dette et des fonds propres. La dette permet l’effet de levier, et incite fortement l’actionnaire à bien faire travailler son capital ; les fonds propres permettent l’apport de fonds supplémentaires sans affecter le taux de rendement de l’actionnaire pour sa part du capital[6].
Ceci est une première raison parmi beaucoup pour laisser en place un impôt du type fonds propres comme l’est l’IS. Une autre est bien sûr la facilité et l’objectivité de la mesure (du moins dans un cadre national, la compétition fiscale posant d’autres problèmes). Mais une troisième raison est plus importante : l’IS, a priori neutre sur le rendement pour l’actionnaire, perd cette belle propriété de neutralité quand il y a des rentes et des surprofits, comme en bénéficient de nombreuses entreprises très performantes ou en position dominante. En fait, l’IS est une taxe pure sur la rente, cette dernière étant rarement justifiée économiquement. Trop souvent, LGM fondent leurs raisonnements sur l’idée d’une économie en situation de concurrence, avec des marchés complets et parfaitement informés. Si ce n’est pas le cas, certains de bons principes fiscaux, notamment le principe d’une affectation précise de l’impôt au service rendu par l’État, disparait. On retrouvera ce point lors de la discussion sur la redistribution par l’impôt.
En clair, un bon impôt sur le capital est probablement un mix d’un impôt fixe du type IK et d’un impôt indexé sur la profitabilité de type IS ou taxe sur les dividendes[7].
Pourquoi tant d’impôts en France ?
LGM s’insurge sur le record que détient la France en matière de prélèvements obligatoires (46,5% du PIB). Ils avancent un argument pour expliquer ce « travers » de notre pays : le choix de l’électeur médian (p. 273). En clair, si une majorité gagne à avoir des prestations publiques plus élevées, alors, par le jeu électoral, les politiques suivront cette majorité, c’est-à-dire là où se situe l’électeur médian. De fait en France, droite comme gauche ont suivi des politiques dépensières, s’accompagnant bien sûr d’impôts élevés et, depuis deux décennies, d’une dette publique sans cesse croissante. L’explication laisse insatisfait : on ne voit pas pourquoi les autres pays démocratiques n’auraient pas leur propre électeur médian placé à peu près au même endroit que chez nous, conduisant aux mêmes conséquences en matière d’impôts levés. Un trait général ne peut pas expliquer une situation spécifique. Intervient probablement, comme le montre LGM, un manque d’efficacité dans la gestion de l’État et une kyrielle absurde de mini-impôts coûteux à collecter et se contredisant parfois les uns les autres. Mais peut-être y a-t-il une explication purement statistique : la protection sociale à la française repose fortement sur des entités publiques, pour la santé, la retraite, et l’enseignement. Pour quelle raison les comptes nationaux désignent comme « prélèvement obligatoire » une cotisation obligatoire de retraite auprès d’une caisse publique (par répartition ou capitalisation, ce n’est pas le point), mais pas si cette même cotisation, tout aussi obligatoire, est gérée par une entité privée ?
Troisième remarque sur le livre, la place importante qu’il donne à la fonction redistributive de l’État. L’État est bien sûr une grosse machine à aider les personnes dans le besoin par des prélèvements sur les personnes qui ont les moyens[8]. Il y a dans le livre une tentative ambitieuse de donner des principes économiques et moraux pour gouverner une juste redistribution et ne pas en rester au postulat rapide : « les riches paieront ». De tels principes, LGM aime à les trouver chez le philosophe John Rawls et notamment dans son célèbre principe de différence selon lequel une inégalité est justifiée si elle permet d’améliorer le sort des plus démunis de la société. Le problème est que ce principe est notablement imprécis et aide peu à recommander un degré spécifique de progressivité de l’impôt ni même le type d’impôt qu’il faut retenir. Une formulation caricaturale, mais pas totalement décalée, du principe de différence, c’est la théorie du ruissellement, par lequel il faut aider les riches, sachant que les pauvres retireront toujours un peu de ce qui pourra couler vers eux[9].
Les auteurs font alors une distinction très forte entre un principe de justice de marché (justice commutative, dans les termes des auteurs repris d’Aristote) où chacun, comme dans un contrat, ne doit recevoir que ce pour quoi il a payé, et une justice distributive où intervient la solidarité nécessaire entre ceux qui ont et ceux qui n’ont pas. Dès que c’est possible, l’impôt ou une cotisation obligatoire doivent correspondre à une prestation reçue par la personne ou le groupe. Par exemple, il est bon qu’il y ait des impôts locaux en contrepartie des services rendus à l’échelle local. Par exemple aussi, il convient que la santé ou la retraite soient financés sur un principe d’équivalence entre la prestation et la cotisation comme c’est le cas pour l’assurance automobile (qui est obligatoire). À l’inverse, des éléments de solidarité, comme l’est le minimum vieillesse, ou de souveraineté comme les sont les services publics de justice, de défense ou de sécurité, doivent être payés par des impôts globaux.
On retrouve ici la distinction classique entre les fonctions assurancielle et de solidarité en matière de providence. Mais cette distinction est assez vaine. Quand on va au fond de l’argument, elle repose sur la possibilité d’attribuer à chacun le service qui lui est rendu, y compris en probabilité, et donc de le facturer comme tel. On en est bien loin. Les prix sont loin de s’établir à leur niveau concurrentiel, les marchés sont loin d’être complets. Quid s’il y a des rentes, ou des salaires trop bas, ou une médecine trop chère ? Thomas Nagel et Liam Murphy, lors de leur réflexion conjointe sur le système fiscal du point de vue de la justice[11], relèvent la fragilité de la notion de revenus avant impôts ou revenus primaires, comme s’ils devaient être la base intangible sur laquelle repose des échanges justes que la fiscalité ne viendrait que polluer. Dit avec les mots de la théorie économique, la justice commutative ne vaut que si les termes du contrat, c’est-à-dire les prix et les revenus, sont eux-mêmes parfaitement « justes », c’est-à-dire résultent d’un équilibre concurrentiel hors position dominante ou privilège. À défaut, l’économiste James Tobin[12] proposait de façon raisonnable la notion d’égalitarisme spécifique, pour désigner les cas où l’État ne transmet pas son aide sociale via des revenus ou des impôts moindres[13], mais par l’intermédiaire de prestations rendues gratuitement ou à un prix inférieur au prix de marché. Une telle redistribution « hors marché » se justifie parfaitement si elle est en pratique plus facile ou moins discriminatoire à opérer. On peut très bien accepter que l’enseignement supérieur soit fortement gratuit, même si les riches, dont les enfants font davantage des études supérieures, vont davantage en profiter. D’autant plus encore si les façons alternatives d’aider les enfants des pauvres à faire leurs études (bourses, crédits contingents ou pas) sont moins efficaces, ou plus coûteuses à mettre en place, ou plus discriminatoires psychologiquement. L’essentiel, c’est qu’au global, il y ait redistribution : le riche y gagne s’agissant des études de ses enfants, mais contribuera par ailleurs d’une autre manière.
Un autre exemple est la santé. Il faut prendre conscience que la caisse d’assurance maladie est en France notre principal instrument de redistribution sachant les sommes en jeu, puisque les gens en paient le coût selon leur revenu et non selon leur état de santé. LGM milite au contraire pour un système d’assurance santé très « actuariel », adossé à un système d’aide sociale santé pour les démunis. Mais cela veut dire que la redistribution reposerait uniquement sur l’impôt, et en particulier le seul impôt idoine pour cette fonction qu’est l’IR. On doute alors que le niveau et la progressivité de l’impôt qui en résulterait soient acceptés politiquement. Et à distinguer strictement assurance et solidarité, on rencontre cette difficulté inextricable de l’aide sociale comme voiture balai : les premiers déciles de la distribution de revenu profitent de la voiture, mais les gens juste au-dessus, en pratique la classe moyenne inférieure, en sont privés, de même que les gens qui quittent le niveau de pauvreté couvert par l’aide sociale (en raison des effets de seuil qui s’appliquent). Un système d’aide sociale « spécifique », par le jeu des prix, est beaucoup plus souple et permet de se dispenser du couperet du niveau de revenu aidé[14]. En fait, l’État providence n’agit que très peu via des transferts directs sans contrepartie (de l’aide sociale) ; il agit par la sécurité sociale, c’est-à-dire un système d’assurance non actuarielle, qui ne respecte pas la vérité des prix. Il y a des raisons de faisabilité politique derrière cela. La redistribution qui s’opère par l’assurance maladie de la Sécu ne fait pester personne ; elle est parfaitement tolérée alors que son effet est majeur. De la même façon, la redistribution négative qu’opère la TVA passe comme une lettre à la poste alors qu’on s’insurgerait si les impôts sur le revenu ou sur un bien comme l’essence étaient décroissants selon le niveau de revenu. Ceci milite sans doute pour un peu d’opacité dans le système de l’État providence. Et « un peu » est un euphémisme, puisque l’OCDE nous dit que la redistribution en Europe s’effectue pour les deux tiers par le truchement des biens gratuits ou facturés à des prix hors marché et un tiers seulement par la progressivité de l’impôt. Le prix à payer pour cela, qui agace les deux auteurs, est l’opacité qui en résulte, ce que d’autres appellent solidarité, c’est-à-dire le sens d’une certaine appartenance à un même communauté politique où l’on tolère de perdre par ici pourvu qu’en gros on s’en sorte bien par là. C’est vrai que si le lien social se délite, l’appel à l’équité actuarielle, à la justice commutative, est d’autant plus fort. Mais il faut voir en sens inverse que c’est cet appel à l’équité actuarielle qui à la longue distend le lien social et empêche de trouver les arrangements où l’on se met à ne plus trop calculer pourvu que la communauté y gagne.
Un mot sur les impôts sur les successions, que les auteurs abordent dans leur chapitre 11. Pour le moins, ils hésitent. Ils font appel à une logique du mérite (pourquoi taxer pareil un capital acquis par l’effort et un capital acquis en dormant ?), de l’incitation (pourquoi épargner si je ne peux rien léguer sans m’en faire confisquer un gros bout) ou de l’évasion (pourquoi taxer les seules gens qui n’arrivent pas à faire passer la frontière à leur patrimoine ?), trois logiques pour justifier des niveaux d’impôts sur les successions bas ou nuls. Peut-être vaut-il mieux un impôt récurrent sur le capital qu’un impôt en une fois sur les successions, cette fois-ci pour l’argument psychologique que c’est plus indolore[15]. Vient aussi dans ce chapitre 11 un long passage, très argumentée, sur la notion d’ « envie », mais dont le lecteur ne peut s’empêcher de penser qu’il est là à titre subliminal, pour associer à la demande sociale de progressivité, de taxation des patrimoines ces vilains défauts que sont l’envie ou la jalousie. L’envie on le sait, et le reconnait LGM (p. 250), a deux visages : haïssable pour soi-même, où il s’assimile à un manque de dignité et de responsabilité ; respectable chez les autres parce qu’il traduit une demande de traitement équitable, naturelle chez les animaux sociaux que nous sommes qui s’attachent moins à leur sort dans l’absolu qu’à leur sort relativement aux autres.
Au reste, l’impôt sur les successions est-il autre chose qu’un impôt sur le revenu de l’héritier ? Si le revenu, selon la définition qu’en donne Hicks, n’est que le montant qu’on peut extraire de son patrimoine sans en affecter la valeur, alors je dispose bien par mon héritage d’un « revenu », c’est-à-dire de quelque chose qui vient en surcroit de mon patrimoine avant le legs. Il n’y a donc pas à s’étonner que les taux d’impôt sur les successions soient du même ordre que ceux qui pèsent sur le revenu. On retrouve là un angle mort du libéralisme classique : c’est pour lui l’individu et non la famille qui est l’unité de base d’un point de vue philosophique, et pourtant la famille vient s’en mêler. Dit autrement, le patrimoine dont j’hérite n’est-il pas déjà à moi, puisqu’il est à ma famille ? On voit la fragilité de l’argument.
Dernière critique, mineure cette fois, et je m’arrête : LGM balaie négligemment l’impôt sur le revenu fictif que perçoit le propriétaire sur le logement qu’il occupe (p. 45). Voici un impôt qui a existé jusqu’en 1963 en France, qui l’est dans d’autres pays et qui est parfaitement fondé économiquement. Je dispose d’un bien capital, machine ou logement. Ce bien me rapporte un revenu, que ce soit sous forme pécuniaire ou en nature, peu importe. On voit mal pourquoi ce revenu échapperait à l’impôt. Il s’agit d’un des mécanismes principaux par lequel la richesse se cumule « en dormant » : le locataire paie son loyer sur base de son revenu déjà imposé ; le propriétaire dispose à la fois la possibilité de s’endetter, et donc de profiter de l’effet de levier si l’immobilier voit son prix progresser et profite de son service de logement hors impôts. On pourra peut-être dire qu’il n’est pas psychologiquement habile de taxer le loyer fictif, et qu’une forte taxe foncière, renforcée par l’IFI, fait tout autant l’affaire, mais on ne peut pas dire que cet impôt ne soit qu’une lubie de Bercy.
Voici quelques réactions qui justifient, on le répète, qu’on lise ce livre. Au fil des pages, il aide le lecteur à façonner ses propres conceptions sur l’impôt. Il renvoie les bonnes balles pour améliorer son jeu.
[1] « Il s’agirait de substituer un impôt universel [c’est-à-dire à taux fixe] sur le capital à tous les prélèvements frappant le capital. […] La base imposable serait la situation nette de chaque agent, ménages et entreprises. » p. 106. Soit dit en passant, on s’interroge sur le fait de taxer à la fois les entreprises (sur leur actif net) et les ménages. Puisque les ménages détiennent les fonds propres des entreprises, il y aurait double imposition.
[2] « Ainsi, la taxation du capital entrave son accumulation » (p. 15) ; « Retenons que l’impôt sur le capital est défavorable à l’accumulation du capital et éloigne d’autant l’économie du la règle d’or ». (p. 101) Il n’y a pas forcément contradiction mais plutôt l’effort des auteurs de mettre à plein jour les difficultés.
[3] Si l’élasticité de substitution est égale à 1, ce qui n’est pas le cas. On l’estime à 0,8, ce qui donnerait -26%.
[4] LGM s’appuient sur un modèle de croissance équilibrée, à la Solow, où en effet le taux de croissance stationnaire ne dépend pas du coût du travail et du capital, mais plutôt de la démographie et du progrès technique dans l’économie. Dans un tel cadre, salaires bruts et rémunération brute du capital sont déterminés par les paramètres « techniques » de l’économie. Et l’impôt n’est qu’une redistribution des revenus entre les agents, outre son financement du secteur public. La taxe sur le capital ne fait que réduire le montant du capital privé par tête et peut affecter la « règle d’or » de l’économie, c’est-à-dire ne pas permettre la consommation par tête maximale. Il est faux toutefois de dire que cette situation n’est atteinte que si l’ensemble des profits est investi et l’ensemble des salaires est consommé (p. 98). Il peut y avoir « règle d’or » même si les salariés épargnent, à condition qu’une partie équivalente des profits soit consommée. Et précisément, comme l’indiquait Samuelson en 1975, le système fiscal ou une sécurité sociale peuvent corriger la chose, en redistribuant du revenu entre les détenteurs de capital et les salariés. En quelque sorte, un « mauvais » impôt peut être amendé par d’autres « mauvais » impôts.
[5] Par le mécanisme du report déficitaire ou par le jeu de la consolidation fiscale qui permet que les pertes d’un projet ou d’une filiale soient imputables sur les profits de l’ensemble, l’État participe aux pertes de l’entreprise. On ne comprend pas dès lors : « L’IS permet [à l’État] de participer aux bénéfices sans subir les pertes », p. 42.
[6] L’IS n’est pas un impôt parfaitement neutre sur le taux de rendement du capital pour l’actionnaire, et de loin. En raison de la présence de la dette, d’un report imparfait des déficits, du jeu de l’amortissement, qui est déductible, etc. Voir à ce sujet : F. Meunier, « Quel impôt sur les sociétés dans une économie mondialisée ? », Telos, 2019.
[7] En s’interrogeant sur la déductibilité fiscale des frais financiers, point non relevé par LGM.
[8] Les auteurs sont plus frontaux dans leur formulation : « sommes enlevées à certains pour être versés à d’autres. » (p. 274)
[9] Ce qui explique que quantité d’auteurs, aussi différents que le sont Hayek pour la droite que Sandel pour la gauche, peuvent se réclamer de Rawls. Le vrai apport de Rawls n’est pas le principe de différence, mais la parabole du voile d’ignorance, par lequel, au sein d’une communauté politique, les gens peuvent être conduit à accepter un contrat social contenant une forte dose de redistribution, ne sachant pas à l’avance leur degré de talents, de chance, de mérite, de capacité et de goût pour le travail, etc. Cela fait exploser toute notion d’aide sociale reposant sur le mérite, dès lors qu’une part importante du mérite personnel n’est qu’affaire de hasard, lié à l’environnement ou aux bons gènes dont on est pourvu. Cette parabole sert aussi à illustrer une certaine inanité de la recherche d’une juste rétribution de chacun au regard des impôts qu’il paie, aussi vaine que le serait la distinction entre ce qui est talent, chance ou mérite dans l’apport de chacun à la société. Il faut ainsi admettre une certaine « opacité » et même inefficacité de la redistribution, à condition qu’elle s’exerce au sein d’une communauté politique démocratique.
[10] Murphy, Liam and Thomas Nagel, “The Myth of Ownership: Taxes and Justice”, Oxford University Press, 2002.
[11] Tobin, James, 1970, “On Limiting the Domain of Inequality”, Journal of Law and Economics, Vol. 13, No. 2, Oct.
[12] Comme le recommandent la plupart des économistes, pour l’avantage laissé à la personne de dépenser le montant de son aide comme elle l’entend.
[13] Ce n’est pas toujours le cas : les cantines scolaires ont un niveau de coût variable selon le niveau de revenu.
[14] Un argument que retient Piketty, lui aussi favorable à des impôts sur les successions relativement bas.
Cet article a été publié sur Vox-Fi le 9 novembre 2020.








Vos réactions
Cet article est très intéressant mais il manque tout un volet pour analyser qui paie effectivement l’impôt. Je renvoie à mon livre publié sur Amazon, « L’économie avec bon sens ». Dans ce livre il est démontré que la richesse mondiale ne croît pas. Il y a donc autant de richesse créée que de richesse détruite. Personne ne s’intéresse à la destruction de richesse. Pourtant celle-ci disparaît majoritairement dans la destruction de biens comme la nourriture mangée ou les objets jetés. Elle est donc essentiellement détruite par les hommes qui sont au bout de la chaîne productive. Plus on est riche plus on compense la richesse détruite par la richesse que l’on crée personnellement. Par contre un pauvre ne fait que détruire la richesse; C’est donc lui qui paie tous les coûts en particulier tous les impôts. Instantanément un riche paie des impôts mais il compensera par une richesse crée qui sera payée par les pauvres. C’est pour cette raison que la France a beau avoir le système le plus redistributif, elle a toujours plus de pauvres toujours plus pauvres. Les impôts n’ont de sens que dans la mesure où ils correspondent à un service efficace ce qui n’est pas la problématique d’un état à finalité sociale. C’est pour cela qu’il faut mieux confier le service à un service privé, à finalité économique, qui lui a un souci d’efficacité. Quant à la redistribution, L’état prend l’argent des classes moyennes pour la donner aux pauvres. Résultat un appauvrissement général de la population. Le seul intérêt de l’impôt est d’orienter l’économie dans une voie ou une autre. Mais le danger est la perte de compétitivité si cette politique fiscale n’est pas accompagnée d’une volonté politique forte pour normaliser, aider la recherche, et accroître la compétitivité sur le marché d’exportation, seul moyen d’accroître la richesse du pays. Ceci est rarement le cas.
moderated