Les tarifs douaniers sont une taxe très régressive
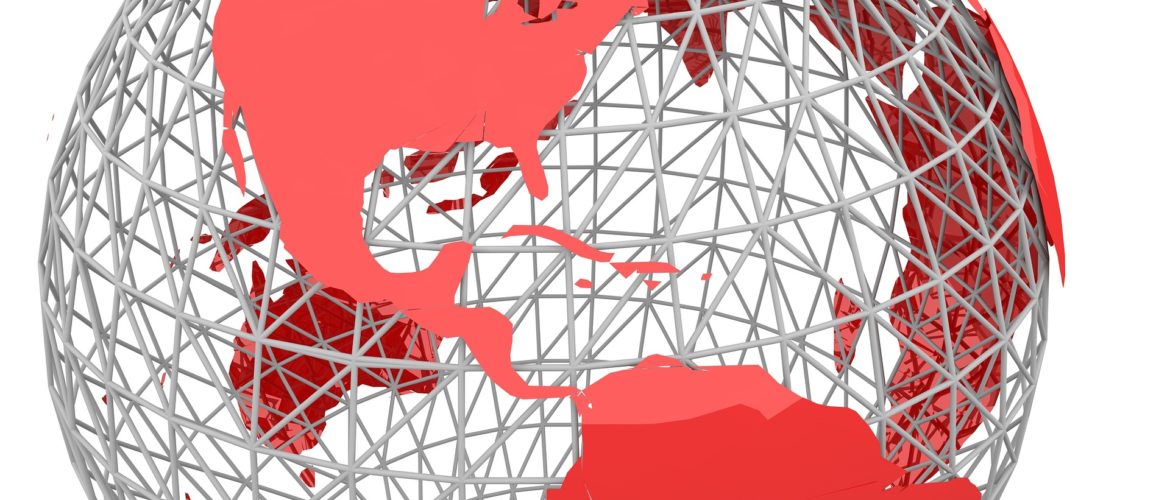
 Il flotte comme une petite musique protectionniste, ces temps-ci. Un des traits remarquables de l’après-crise de 2008 avait été la forte différence avec la crise de 1929 : cette dernière avait rapidement dégénéré en un bétonnage douanier généralisé, qui avait amplifié et propagé au monde entier le choc survenu aux États-Unis. Rien de tel, il faut s’en féliciter, pour celle de 2008. La chute d’activité suite à la dernière crise financière a été de l’ordre de huit fois moins élevée que lors de la Grande dépression des années 30.
Il flotte comme une petite musique protectionniste, ces temps-ci. Un des traits remarquables de l’après-crise de 2008 avait été la forte différence avec la crise de 1929 : cette dernière avait rapidement dégénéré en un bétonnage douanier généralisé, qui avait amplifié et propagé au monde entier le choc survenu aux États-Unis. Rien de tel, il faut s’en féliciter, pour celle de 2008. La chute d’activité suite à la dernière crise financière a été de l’ordre de huit fois moins élevée que lors de la Grande dépression des années 30.
S’en féliciter ? Sauf pour les bruits que soulève à présent l’arrivée de Trump à la Maison blanche, et le relais qu’entendent prendre les partis populistes en Europe dans les élections à venir.
Le graphique de cette semaine n’entend pas bien-sûr ouvrir le débat immense du protectionnisme. Simplement souligner un point : une taxe à l’importation, qui est bien-sûr payée par les consommateurs du pays qui importe, est surtout payée par les plus pauvres d’entre eux. Le graphique met en horizontal le montant de taxe à l’importation aujourd’hui payé par les ménages américains (au total, pour l’année 2015, 33 Md$, soit 0,2 % du PIB) en proportion de leur revenu avant impôt. Et il met en vertical le poids de cette taxe selon le décile de revenu, allant du plus bas au plus élevé. Cela représente une charge de 1,6 % pour les plus pauvres, moins de 0,3 % pour les plus riches.
Ce graphique d’un papier produit par Jason Furman et ses collègues, et qu’on peut lire dans Vox-EU du 12 janvier 2017. (Furman est le président actuel du CEA, Council of economic advisors, nommé par le président Obama. Il ne va pas y rester longtemps !)
La raison ? Simplement, plus un ménage a des revenus bas, plus la part de produits manufacturés est importante dans son budget. Or, ce sont les produits manufacturés qui sont les plus importés et l’objet de la protection douanière la plus lourde.
On pourrait souhaiter une autre approche du phénomène, consistant à reconnaître que les ménages ont un niveau de consommation incompressible, loyers, remboursement du crédit logement, énergie, essence, etc. Autant de produits, y compris l’essence aux États-Unis, qui ne sont pas importés. Observe-t-on alors le même phénomène si on mesure la part de cette taxe à l’import sur les dépenses « libres », c’est-à-dire hors coût du logement et services collectifs (eau, gaz, électricité, etc.) ? Absolument, même si l’effet est moins marqué.
Conclusion : les taxes à l’importation sont 1) des impôts à la consommation, et 2) très régressifs. Avant même les bruits de botte protectionnistes, avant donc une éventuelle remontée des droits de douane (notamment pour payer le fameux « mur » coupant les éleveurs du Texas de l’accès au Rio Grande), c’est bien l’électorat de Trump qui trinque.
Évidemment, la rhétorique trumpienne met en avant l’autre côté de la balance : non pas le consommateur, mais le producteur, celui qui va perdre son emploi si les biens sont produits à l’étranger. Mais voici qu’on rentre dans le débat qu’on souhaite éviter ! À dire simplement ici qu’une taxe à l’import qui monte dans un pays appelle une taxe à l’import qui monte en rétorsion dans un ou plusieurs pays, ce qui conduit au détricotage du commerce international connu à d’autres époques, et qui a toujours été associé à des pertes violentes d’activité (l’Allemagne de 1933 n’étant pas du tout le contre-exemple brandi par certains, s’il nous fallait souhaiter que nos pays aujourd’hui copient ce modèle).
Cet article a été publié sur Vox-Fi le 15 février 2017.









