« Les Trente glorieuses sont devant nous ! »
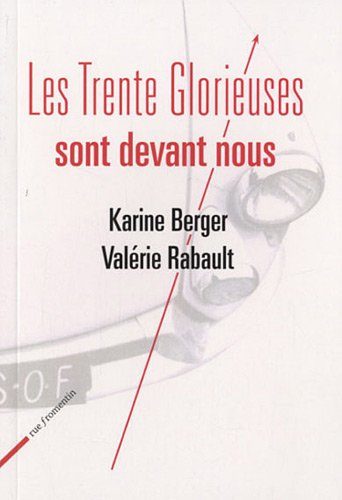
Le livre de Karine Berger et de Valérie Rabault, Les Trente glorieuses sont devant nous, fait parler de lui. A raison. Son esprit : refuser le déclinisme à la française. Sa thèse : la France peut reprendre un chemin de croissance, mais à la condition préalable qu’elle assume pleinement, contre les modes actuelles, ce qu’elle est ; qu’elle retrouve son modèle propre, sa marque de fabrique, à savoir le « modèle français », celui qui a prévalu au moment de la reconstruction de la France après la 2e Guerre mondiale et qui lui a assuré les « Trente glorieuses », entre 1945 et 1975.
Dans le climat présent et à environ un an d’une élection présidentielle importante, le livre dénote. Il utilise un « truc » dont les psychologues connaissent l’efficacité et qu’on appelle le « renforcement narcissique ». Les Français n’ont pas le moral, perdent leurs repères, n’ont plus foi en leurs valeurs qu’ils voient contestées par la mondialisation, par les crises qui nous entourent, par une certaine médiocrité du personnel politique. La recette, plutôt que de ressasser nos insuffisances et de se complaire dans une envie-rejet des Anglo-Saxons, est de retrouver nos racines, ce modèle qui a si bien réussi pendant plus d’une génération.
Car le modèle français ne se réduit pas, selon les auteures, à l’image première qu’on en a, à savoir un « modèle social », assurant un haut niveau de protection à la population. Cela a été, en premier lieu, un modèle économique, fait d’initiatives de l’Etat, notamment en faveur de l’industrie, de l’éducation et de la recherche, de partage de risque avec le privé. Il est illustré dans ce qui est devenu un mythe fondateur, même aux yeux de l’étranger, à savoir le triptyque « TGV, nucléaire et Airbus ». Mais, bien qu’économique, il se combine avec une redistribution assez égalitaire des gains de la croissance, qui assure le bon fonctionnement de l’ascenseur social, l’adhésion de tous à un projet collectif et, en général, l’ouverture culturelle au monde. C’est par là qu’on retrouve le volet social du modèle.
Ajoutez à cela un discours qui (me) plaît bien : un certain productivisme d’ingénieurs, une vision économique tirée par l’offre et la croissance, la confiance en la technologie ; et peut-être moins consensuel, son appel à une politique plus décomplexée sur l’immigration, bien entendu indispensable à la croissance et au bien-être du pays sur la durée et qui pourrait, paradoxalement, réduire la fixation collective que la population se fait aujourd’hui sur ce sujet et qui laisse si perplexes les partis de gouvernement.
Tout cela fait hagiographie. Pourquoi pas, si c’est bon pour le moral. Mais comment passer du stade du renforcement psychologique aux propositions d’action collective ? Pour nos deux auteures, la réponse est simple : il faut enclencher une dynamique, dans la logique de l’effort de l’Etat après la guerre, et donc en passer par une forte vague d’investissement public. Malgré la situation budgétaire, l’Etat s’en donnera les moyens, notamment par un grand emprunt levé en trois ans sur les marchés.
La thèse me semble éluder deux difficultés :
1) D’abord dans l’interprétation de ce qu’ont été les « Trente glorieuses » et dans la valeur de mythe que mérite de prendre cette époque. L’événement n’a pas été singulier à la France. On l’a observé dans toute l’Europe non communiste au sortir de la guerre. Les chiffres montrent même que l’Allemagne, l’Italie ou la Scandinavie ont connu des redressements plus spectaculaires. Et là aussi, dans une Europe ravagée, par une forte combinaison d’initiative publique et d’investissement privé. Avant même la guerre, suite à la crise de 1929, les pays avaient déjà mis l’Etat davantage en selle, les Etats-Unis bien sûr, mais aussi la France, et l’Allemagne hitlérienne dans une modalité particulière. La composante sociale de ce modèle, née en France sous l’initiative du Conseil national de la résistance, se retrouvait à l’égal dans d’autres pays d’Europe, et reprenait dans le détail ce que le New Deal de Roosevelt avait mis sur pied dans les années trente : la Sécurité sociale conçue par Pierre Laroque au sortir de la guerre reprenait très exactement la Social Security de Roosevelt. Ce qui est propre à la France est davantage d’ordre mental ou spirituel, à savoir un optimisme regagné, chez cette vieille nation humiliée par la défaite, prenant conscience de sa vitalité renouvelée, malgré sa perte d’influence et le gâchis des guerres coloniales. Son élan démographique, dont la spécificité en Europe reste mal comprise des démographes, tire peut-être de là son origine.
Je dirais plus encore que ce modèle se rencontre peu ou prou dans tous les décollages économiques ou toutes les périodes de rattrapage. N’a-t-il pas été suivi, pour chacun d’eux avec leurs spécificités, par les pays asiatiques comme le Japon, la Corée, Singapour, maintenant la Chine, à savoir la combinaison d’un Etat entreprenant, d’une situation de départ où les besoins privés et sociaux de la population sont mal assurés, et où la logique est de « rattraper » les autres, de bénéficier grâce à l’ouverture des échanges des progrès techniques réalisés ailleurs. La dynamique de croissance nourrit alors une spirale vertueuse : l’Etat, qui a encore une implication faible dans la redistribution, peut accroître ses dépenses et lever des impôts. Les leviers de l’éducation, de l’investissement matériel, de la mise en place de services publics efficaces sont immenses. Les inégalités sociales sont masquées par le fait que tout le monde bouge, que les jeunes ont raisonnablement l’espoir d’une vie matérielle meilleure que celle de leurs parents.
Arrive un temps plus difficile : le pays atteint la « frontière technologique », celles où les gains de productivité sont beaucoup plus lents, ne dépendent plus de la simple mise en œuvre de facteurs de production mal utilisés ou de technologies mises au point à l’étranger, aux Etats-Unis dans le cas de l’Europe d’après-guerre. Il faut de l’innovation en dur. Certains pays asiatiques en arrivent là aujourd’hui. L’Europe y est depuis une ou deux décennies, ayant en termes de productivité comblé quasiment son retard sur les Etats-Unis. Les Etats-Unis eux-mêmes, qui sont « à la frontière » depuis la sortie de la guerre de 1914, ont connu une crise similaire dans les années 1980 (rappelons-nous du discours sur le rattrapage par le Japon), avant de connaître leur décennie magique des années 1990 et partiellement de 2000, où, sans doute grâce à leur dispositif supérieur en matière d’éducation universitaire et de recherche, ils ont connu une nouvelle phase de croissance portée par la technologie.
A ce stade de maturité, le rôle de l’Etat est moins facile à concevoir. Où faire porter l’effort ? Les auteures reprochent au grand emprunt de Guaino de s’être dispersé. Mais elles offrent une liste déjà très longue de cinq priorités pour leur grand emprunt à elles (de 90 Md€) : l’éducation, l’énergie, les transports, la santé et – originalité – l’agriculture. Cette liste oublie probablement le logement, l’aménagement du Grand Paris, les technologies de l’information ou la biotechnologie. L’effort moderne de l’Etat, dans un pays à maturité, est forcément dispersé et émietté, c’est-à-dire multiple. Il n’y a plus de recette simple, d’aiguille de boussole, comme lorsque le pays manquait d’un réseau routier, d’un réseau d’hôpitaux ou de barrages hydroélectriques.
Le livre ne peut donc se contenter d’en rester à un guainoïsme de gauche, si plaisant et fortifiant qu’il soit de voir réévalué le rôle de la croissance et de la technologie, d’une économie de l’offre et des études d’ingénieurs par rapport aux formations liées à la finance.
2) D’autant que le livre manque d’une réflexion sur ce qui faut appeler la crise actuelle de l’Etat, un diagnostic qui n’existe pas uniquement dans l’esprit d’ultralibéraux bornés. Pour cela, il faut regarder l’Etat non pas sous son volet d’intention collective, mais en tant qu’instrument, c’est-à-dire comme une industrie de services à très haute valeur ajoutée devant délivrer des services publics au pays. Cet outil s’est enrayé en France. Il y a là tout le débat sur la dépense publique et son efficacité (qu’à tort on prend aujourd’hui par le seul aspect de l’endettement public). L’Etat d’après-guerre était un Etat insuffisant en taille, mais avec une capacité d’impulsion beaucoup plus élevée et un niveau de productivité unitaire de l’agent public bien plus importante qu’aujourd’hui, si on la compare avec la productivité du secteur privé de l’époque. Aujourd’hui, la fonction publique est mal répartie, peu flexible, et en conséquence trop souvent mal rémunérée et mal considérée (qu’on songe aux enseignants, si importants pour le futur d’un pays, aujourd’hui une population paupérisée). Faire mieux, avec des moyens mieux utilisés. Cela doit faire partie du programme de tout candidat politique dans le contexte préélectoral. Promettre un nouveau sursaut budgétaire, un dernier geste de bravoure par l’investissement, le dernier avant la sagesse budgétaire on le promet, n’est plus à l’ordre du jour. On dit qu’en matière d’énergie, l’investissement le plus rentable aujourd’hui se trouve dans les économies d’énergie. N’en va-t-il pas de même pour l’action publique ? Le meilleur investissement pour lui faire retrouver efficacité et légitimité (si utile pour faire accepter l’effort fiscal) consiste à investir massivement dans une meilleure productivité de son propre outil industriel.
La « bravoure » budgétaire s’assimile à une fuite en avant. Elle ne s’est jamais interrompue et c’est à tort que les auteures situent à 1995 (c’est-à-dire la présidence de Chirac, peut-être par respect pieu pour la présidence Mitterrand) la rupture avec l’esprit des Trente Glorieuses. Les gouvernements qui ont suivi, surtout à droite, ont toujours brandi une forme ou une autre de guainoïsme : la rupture chiraquienne de 1995, contre les injonctions conservatrices de Balladur ; la rupture à nouveau qui a permis à Sarkozy de bousculer ses adversaires, au moment où une partie de l’opinion, y compris à gauche, était plus sensible à un discours gestionnaire en matière de finances publiques. De même, les gouvernements précédents, même à gauche, avaient pris conscience, approximativement depuis le milieu des années 1980, de la difficulté d’un activisme de l’Etat en matière industrielle (les Trente glorieuses ont économiquement pris fin en 1975).
De la même façon, il n’y a aucun débat sur un des thèmes propres à la France, qu’on retrouve pourtant bien dans une série d’ouvrages récents : à savoir que le fonctionnement plus complexe d’une économie à maturité exige une gouvernance plus participative, des institutions plus démocratiques, des contre-pouvoirs mieux établis. C’est un paradoxe du mal français (pour embrayer à mon tour sur le langage décliniste) que la France dispose en Europe de l’exécutif le plus puissant institutionnellement et pourtant l’un des moins capables de conduire les réformes. La crise française est aussi une crise de gouvernance. Remettre aux manettes une couche d’ingénieurs polytechniciens n’est pas l’unique remède.
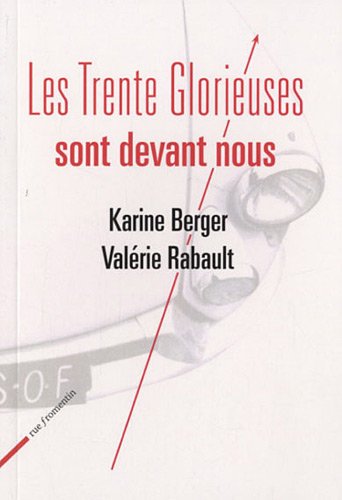
Les Trente glorieuses sont devant nous. Karine Berger et Valérie Rabault. Editions rue fromentin. 20 €.







