L’impôt sur les sociétés dans un monde globalisé
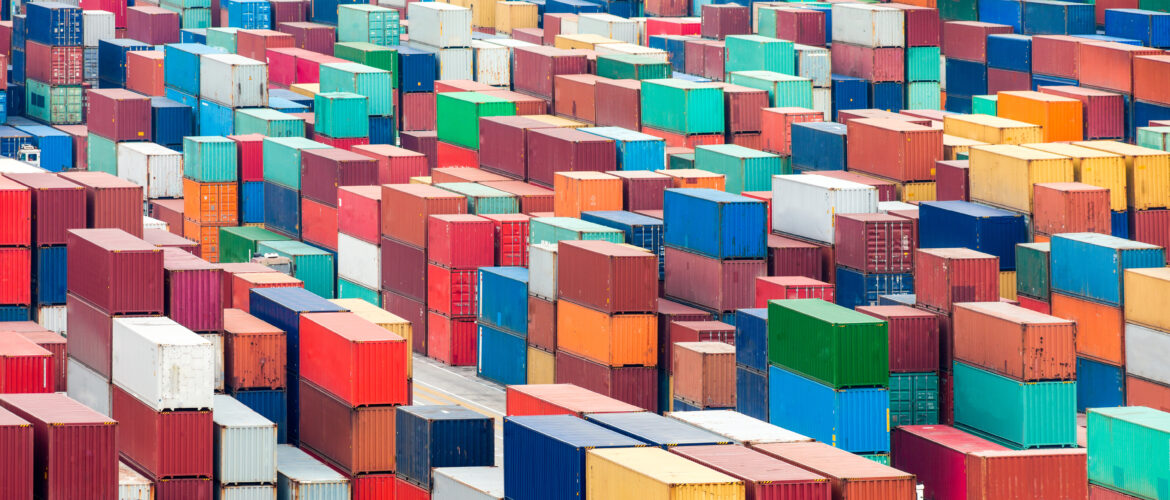
L’initiative prise par le président Biden est historique. Si le projet passe au Congrès, le taux de l’impôt sur les sociétés (IS) sur les sociétés américaines sera relevé de 21 % à 28 % (venant de 35 % avant la réforme Trump de 2017) et surtout un taux minimum de 21 % sera mis en place. Ainsi, une multinationale comme Google qui localise le gros de ses profits européens en Irlande paiera le taux en vigueur qui est de 12,5 % aujourd’hui, mais sera encore redevable de 8,5 % au Trésor étatsunien, ceci même si elle laisse les sommes en Irlande ou dans quelque paradis fiscal. Collecter ses profits en Irlande deviendra clairement moins intéressant. Et l’Irlande elle-même trouvera moins intéressant de conserver son taux bas devant le manque à gagner de 8,5 %. Les fiscs des autres pays européens ne peuvent que s’en réjouir. On pourrait même voir l’Europe suivre les États-Unis sur ce taux minimum à 21 % (elle discute aujourd’hui de mettre un taux minimum à… 12,5 % !).
Lire aussi : Quel impôt sur les sociétés dans une économie mondialisée ?
Il faut s’en féliciter pour une autre raison : l’IS est, parmi tous les impôts, l’un des meilleurs (ou l’un des moins mauvais) du point de vue des distorsions que tout impôt entraîne en aval sur le système des prix et sur les comportements. En particulier, le niveau du taux d’IS a très peu de conséquences sur le comportement de l’entreprise en matière d’investissement et d’emploi. Les taux d’IS étaient couramment de l’ordre de 50 % dans le monde il y a trois décennies (et même de 60 % dans le cas de l’Allemagne), sans que les économies – beaucoup moins ouvertes sur l’extérieur il est vrai – s’en portent plus mal.
L’IS est un impôt sur le profit de l’entreprise et non sur son chiffre d’affaires. Cela veut dire que les dépenses que fait l’entreprise sont déductibles du revenu imposable. La déduction est immédiate pour les dépenses courantes (salaires, consommations intermédiaires), étalée dans le temps pour celles d’investissement, par le mécanisme de l’amortissement fiscal, avec bien sûr un effet sur la trésorerie de l’entreprise, atténué aujourd’hui en raison des taux d’intérêt très bas mais qui peut être non négligeable si l’entreprise n’a pas un accès facile au financement par dette.
Autre caractéristique clé de l’IS dans la quasi-totalité des pays : si jamais l’entreprise fait une perte plutôt qu’un profit, elle dispose, par le mécanisme du report fiscal déficitaire, d’un crédit d’impôt qu’elle fera valoir sur ses profits futurs, le plus souvent de façon indéfiniment reportable, mais là encore en supportant pendant cet intervalle de temps le coût en trésorerie[1]. En quelque sorte, l’État participe tant aux profits qu’aux pertes de l’entreprise, avec les exceptions que nous allons voir.
Un petit exemple l’illustre simplement.
Soit, cas n°1, une entreprise détenue par un unique actionnaire. Elle exploite en France un nouveau projet qui coûte 1 000 et qui rapporte 100 de profit avant IS. Le taux de rendement de cet investissement est de 10 %. Sachant un taux d’IS de 25 %, l’entreprise acquitte 25 d’impôt et verse le reste en dividendes, supposons-le. L’actionnaire subit un impôt sur ce dividende, mettons de 33 % sous forme d’IR, soit encore 25[2].
On entend souvent que l’actionnaire subit un taux d’imposition global de 25 + 25 = 50. Rapportée au 100 de revenu initial, cette somme représente une charge fiscale de 50 % qu’on compare souvent à la fiscalité qui porte sur le travail (mettons encore 33 %, auxquels s’ajoutent des charges sociales[3].
Dans cette acception, l’IS est un acompte sur un impôt que va payer l’actionnaire. Si l’actionnaire détenait l’entreprise en propre (sous forme d’entreprise individuelle non soumise à IS en France ou de S-corporation aux États-Unis), il toucherait 100 et ne paierait que 33. Les fiscs en général pourchassent cet arbitrage. Curieusement, très peu aux États-Unis où S-Corps fleurissent, même si la réforme Trump de 2017 y a un peu mis le holà.
Certains pays, particulièrement généreux pour les revenus du capital comme l’Australie, le Chili ou il y a bien longtemps la France avec l’avoir fiscal, pratiquent ce qu’on appelle l’intégration : l’IS devient un précompte. L’actionnaire se voit imputer la part d’IS qu’il a payé sur sa dette fiscale au titre de l’IR. Dans notre exemple, le fisc remarquerait que celui-ci doit 33, mais qu’il en a en quelque sorte déjà « payé » 25 au niveau de sa société, de sorte qu’il ne lui en reste que 8 à acquitter.
Imaginons à présent un cas n°2 où il n’y a pas d’IS et qu’à la place d’un unique actionnaire il y en ait deux, le second détenant 25 % du capital. Ce dernier touchera donc 25 quand le résultat est un profit de 100 ; il aura un manque à gagner ou une perte de 25 quand le résultat est une perte de 100.
Question : en quoi la position financière de l’actionnaire principal change-t-elle entre le cas n°1 et le cas n°2. En rien en première analyse. Si tout va bien, il touche dans les deux cas 75 de dividende. Dans le cas n°2, sa mise de fonds est de 750 pour un revenu de 75, soit donc 10 % de rendement. Mais c’est la même chose dans le cas n°1 : sa mise de fonds aura été de 1 000 au lieu de 750, mais le fisc va lui rembourser les 250 qui sont les dépenses d’investissement déductibles. Son revenu est toujours de 75 pour une mise de fonds final de 750. Son rendement est toujours de 10 %.
L’État est donc en quelque sorte comme un actionnaire minoritaire. Et un actionnaire minoritaire accommodant puisqu’il ne demande pas à être représenté au conseil d’administration ni d’avoir voix au chapitre sur la marche de l’entreprise. Sa seule exigence est que les comptes soient fidèles pour qu’il n’y ait pas d’évasion de profits, et donc un manque de revenu fiscal. C’est un service qu’il rend d’ailleurs à l’ensemble des actionnaires minoritaires qui, à défaut, pourraient être victimes de captations indues de profit à l’avantage du majoritaire.
Avant de voir ce qui peut perturber ce raisonnement, examinons un cas n°3 où l’entreprise fait son investissement en Irlande où le taux d’IS est de 12,5 %. Par rapport au cas n°1, l’actionnaire à 100 % a cette fois à ses côtés un quasi-actionnaire à 12,5 % plutôt que 25 %. Mais de la même façon, le rendement de son investissement reste de 10 %. Rien n’a donc changé si ce n’est que pour obtenir ce même rendement, il doit mettre sur la table 87,5 plutôt que 75. Le levier de fonds propres est moindre en Irlande. Ce qui est dommageable, c’est un cas n°4 où l’entreprise fait son investissement en France, se fait rembourser 25 % de ses dépenses en France par le fisc français, mais arrive à exporter par des combines plus ou moins légales son profit en Irlande. Le fisc français se fait voler 25 et l’actionnaire et le fisc irlandais se partagent chacun à moitié le butin : le fisc irlandais directement par levée d’impôt à hauteur de 12,5, l’actionnaire indirectement par un gain fiscal de 12,5 sur ses dépenses. Voici alors un impôt qui était neutre sur le rendement du capital pour l’actionnaire, mais qui devient subitement extrêmement profitable dans le cas de transferts illicites de profit. On voit la similitude avec le cas où l’actionnaire majoritaire commet un abus de bien social au détriment de l’actionnaire minoritaire.
Lire aussi : L’impôt sur les sociétés en France et en Europe
Les limitations à ce raisonnement
On en a déjà vu deux :
- L’investissement est amortissable fiscalement (sur dix ans mettons). L’État ne « paie » donc sa part qu’au compte-gouttes : un dixième par année. L’actionnaire fait donc crédit à l’État.
- Le report fiscal déficitaire implique une avance de trésorerie de l’entreprise. Il est même parfois à durée limitée, c’est-à-dire non reportable au-delà d’une certaine période.
Il y en a trois autres :
- On supposait initialement qu’il s’agissait d’un nouveau projet d’une entreprise existante. Si cette entreprise est profitable, elle impute tout de suite ses dépenses sur le profit au niveau du groupe. Elle n’a même pas le coût en trésorerie. C’est vrai aussi si le nouveau projet est au sein d’une filiale, par le mécanisme de la consolidation fiscale (par intégration des filiales dans le calcul de l’impôt au niveau du groupe). Par contre, s’il s’agit d’une start-up, l’État attend qu’elle soit rentable pour « payer » la part qu’il doit : le risque est pendant ce temps intégralement sur le dos de l’entreprise et donc de l’actionnaire. On voit ici une distorsion notable de l’IS au détriment des nouvelles entreprises et à l’avantage des entreprises en place. Une réforme pourrait être envisagée en ce sens. Voir plus bas.
- Si le projet est une entreprise indépendante et fait des pertes, par exemple de 100, l’État et l’actionnaire ne sont plus nécessairement dans des situations parallèles. Si l’entreprise a déjà des réserves, à savoir des profits accumulés dans le passé, l’un et l’autre sont affectés pareillement : l’un ne touche pas l’IS, l’autre son dividende. Si par contre l’entreprise n’a pas de réserves – à nouveau une jeune entreprise –, l’actionnaire doit « remettre au pot » et le faire pour lui, soit 75, et pour la part que l’État n’assume pas, soit 25. En contrepartie, il acquiert une créance sur l’État de 25 remboursable au moment où il fera des profits.
- L’IS n’est pas neutre en cas de faillite. Si le projet échoue avant d’être rentable, l’État n’aura jamais payé sa part fictive de 25% alors qu’il est créancier prioritaire dans le syndic de faillite. De même, il ne remboursera pas, pour sa part, le solde du capital non amorti, même si l’entreprise a été rentable dans le passé et qu’il n’y a pas de report fiscal déficitaire.
Ces différents facteurs représentent des coûts pour l’entreprise et donc pour ses actionnaires, à un niveau qui dépend de sa situation spécifique. Le principal est le coût d’opportunité de la trésorerie, faible en cas de taux d’intérêt bas, mais à nouveau dirimant si l’entreprise est rationnée dans son financement. Ces coûts sont croissants à la fois avec le taux d’IS et avec le taux d’intérêt. Dans le cas extrême où le taux d’IS est à 100 %, tout bloque évidemment puisqu’il n’y a plus personne pour avancer les fonds initiaux de l’investissement.
Un effet important joue toutefois dans l’autre sens, à savoir l’endettement. On le sait, la charge d’intérêt de la dette, c’est-à-dire le revenu de l’investisseur prêteur, est déductible d’IS. L’État en tant que « quasi-actionnaire » reste dans la même position relative vis-à-vis de l’actionnaire : il profite pareillement de l’effet de levier de dette. Le rendement de son « investissement » (à savoir la fraction des dépenses qu’il assume) n’est pas affecté. Par contre, il ne perçoit pas l’IS sur la charge d’intérêt. L’endettement est un gros avantage donné à l’actionnaire, payé par le fisc, et cette fois, un avantage croissant avec le taux d’IS et le taux d’intérêt. Cela compense, souvent au-delà, les coûts mentionnés précédemment.
Quel est le bilan de ces différents effets ? Dans un article de 2018, Robert Barro et Jason Furman montrent, à l’occasion de travaux sur la réforme fiscale conduite par Trump en 2017, qu’une baisse d’un tiers du taux d’IS (de 35 % à 24 % dans leur simulation) ne fait baisser que de 4 % le coût de l’investissement, et ceci même en ignorant l’effet positif pour l’actionnaire de l’endettement.
Sur cette base, beaucoup d’économistes jugent qu’il n’est que partiellement légitime d’additionner (d’« intégrer ») le taux d’IS avec le taux de fiscalité sur les dividendes ou les plus-values perçues par l’actionnaire pour mesurer le poids de la fiscalité sur l’actionnaire. Est-ce à dire que l’IS ne frappe pas les actionnaires ? Oui, mais facialement, en raison d’un effet de définition : l’impôt est toujours payé in fine par des personnes physiques. Dans le cas de l’IS, il est formellement payé par les entreprises et les actionnaires à partir d’un financement et d’un risque pris largement en charge par les États.
Une proposition de réforme de l’IS
Des économistes, notamment Alan Auerbach[1], ont proposé une réforme de l’IS qui rétablit la neutralité parfaite entre les taux de rendement de l’actionnaire et de l’État : elle consiste à ne plus taxer le résultat comptable, mais le flux de trésorerie disponible[2]. Voir à ce sujet ce billet de Telos. Notamment, les charges d’intérêt ne seraient plus déductibles d’IS, ceci pour mettre à égalité les deux classes d’investisseurs que sont les actionnaires et les obligataires ou créanciers bancaires. Et pour éviter les transferts de profit entre pays à taux de taxation différents, un mécanisme d’ajustement à la frontière, similaire à ce qu’on observe sur la TVA. Du point de vue de l’auteur de ce billet, c’est une réforme à envisager sérieusement. Évidemment, aller au bout de la logique cash suppose que l’État participe aux premières dépenses d’investissement, avant même qu’il y ait des profits. Et de même, que disparaisse l’amortissement. C’est une réforme complexe à mettre en place parce qu’elle occasionnerait en une fois des transferts importants de trésorerie entre les secteurs économiques. À tout le moins, il faudrait supprimer la déductibilité des frais financiers de la base imposable[3].
Or, une distorsion majeure a commencé à apparaître à propos de l’amortissement. Les entreprises sont de plus en plus numériques et leur capital est, dans une proportion croissante, immatériel. Des sociétés comme Airbnb ou Spotify ont des coûts, y compris en matière de logiciels, qui sont récupérables immédiatement ou dans un délai très bref. Une cimenterie ou un projet de parc éolien amortit ses fours ou ses turbines sur 20 ou 25 ans. Le mécanisme de l’amortissement fiscal est de moins en moins adapté aujourd’hui de par les distorsions sectorielles qu’il entraine. Notamment, il pénalise les lourds besoins d’investissement en dur que suppose la décarbonisation de l’économie. Voici qui peut être corrigé par un IS qui se rapprocherait des flux de trésorerie.
À nouveau, l’IS ne modifie que peu le comportement des entreprises
La concurrence fiscale est comme on l’a vue un avantage de compétitivité financière pour les entreprises qui arrivent à mettre sur pied cette évasion. Une réponse constante des gouvernements a été de baisser l’IS, comme le montre le graphique ci-après.

Quelle est la conséquence de cette baisse ? On a un cas d’école avec la réforme introduite par Trump en 2017, consistant à passer le taux d’IS de 35 à 21 %. Il n’y a eu aucun rapatriement d’emploi et ceci pour une raison simple : ce n’était pas les emplois qui étaient partis pour profiter des impôts bas, c’était les profits. Google et Apple n’avaient investi que dans des unités légales quasiment vides d’actifs en Irlande, et plus vides encore aux Iles Caïman. Quand les emplois ont quitté les États-Unis, c’était pour aider à l’expansion internationale du groupe, pour profiter d’opportunités de marché ou de coûts de production, et non pour payer moins d’impôts, puisqu’il suffit pour y échapper de déplacer les profits sans bouger ni actifs ni emplois. Si les emplois avaient été dirigés là où l’on paie moins d’impôts, on verrait une masse de salariés de Google et de Apple aux Iles Cayman et en Irlande et non en Allemagne ou à Taiwan. Le groupe qui s’en sort mieux qu’un autre à ce jeu pourra mieux récompenser ses actionnaires et donc disposer d’un potentiel plus fort à se financer.
Lire aussi : L’impôt sur les sociétés et les profits de monopole
Le phénomène d’évasion a pris des proportions gigantesques dans le cas des États-Unis. Cinquante-cinq des plus grandes entreprises du pays – dont FedEx, Nike et le géant de l’agroalimentaire ADM – n’ont rien payé en impôts fédéraux sur le revenu en 2020, alors qu’elles ont déclaré collectivement plus de 40 Md$ de bénéfices, selon l’Institute on Taxation and Economic Policy.
Dans une étude de 2019, le FMI écrit : « Selon les statistiques officielles, le Luxembourg, pays de 600 000 habitants, accueille autant d’investissements directs étrangers (IDE) que les États-Unis et beaucoup plus que la Chine. Les 4 000 Md$ d’IDE du Luxembourg représentent 6,6 M$ par personne. Des IDE de cette taille ne reflètent guère les investissements matériels dans la minuscule économie luxembourgeoise.» L’étude y voit simplement des « investissements fantômes » qui n’accroissent pas la profitabilité opérationnelle, celles obtenues à partir d’investissements matériels, mais la seule profitabilité actionnariale sur le dos des États. En effet, les IDE sont définis comme des investissements financiers transfrontaliers entre des entreprises appartenant à un même groupe multinational, donc de Amazon États-Unis vers Amazon Luxembourg en contrepartie de quoi ces actifs perçoivent le gros des profits européens du groupe. Les États-Unis y perdent, les autres pays européens y perdent et le revenu par tête des Luxembourgeois (et des Irlandais, et à un degré moindre des Néerlandais, des Autrichiens ou des Chypriotes) comptent parmi les plus élevés au monde.
L’IS français est élevé, mais ceci n’empêche nullement les grands groupes français et étrangers d’investir en France (les IDE ont été plus élevés en France qu’en Allemagne ou en Grande-Bretagne en 2020). Si l’on investit moins ou plus en France, c’est pour des raisons structurelles tenant à la taille relative du marché, à la qualité relative de la main-d’œuvre, de l’infrastructure, de l’administration, etc., pas à des taux d’IS relativement plus élevés puisqu’il est possible d’y échapper par évasion des profits. L’IS ne fait pas partie des coûts de production et son impact sur les taux de rendement de l’actionnaire (hors évasion fiscale) est modeste.
Si donc baisser les taux d’impôt a si peu d’effets « réels » au-delà des statistiques, on soupçonne que les monter n’en aura guère non plus. L’IS est un impôt globalement neutre sur les comportements, qu’il faut renforcer.
On entend souvent dire que l’IS est un impôt sur le surprofit ou sur la rente. Pourquoi ? Il faut revenir ici à la question de l’amortissement. Au terme de la période d’amortissement, on peut dire que l’État a « remboursé » intégralement sa part des dépenses, et qu’il touche sa « juste » part des profits obtenus. Deux cas de figure alors (on suppose ici que l’entreprise distribue en dividende tout son excédent de trésorerie). Si l’entreprise vaut en valeur marchande uniquement le capital investi au départ, les deux « partenaires », actionnaires et État, sont quittes. Si par exemple le coût du capital est de 10 %, une entreprise qui rapporte du 10 % brut rémunère exactement les 10 % perçus par les deux « partenaires » au prorata de leurs parts [1]. Mais si le coût du capital est de 8 %, la rémunération de 10 % est l’indice d’un « surprofit » de 2 %. Et la valeur de l’entreprise rapporté au capital investi (le price-to-book ou q de Tobin) est de 10/8ème, soit 1,25X. Or, on sait que si l’entreprise est dans un secteur très concurrentiel, elle est obligée de rétrocéder dans ses prix ou ses coûts l’intégralité de son surprofit[2]. Si le coût du capital reste de 8 %, sa rentabilité opérationnelle descend à 8 % et le P-to-B à 1X. Autrement dit, l’État « rembourse » bien le capital immobilisé, mais jouit au-delà d’un montant de 25 % sur le surprofit dégagé, une rente sur une rente, en quelque sorte.
À ce stade, le raisonnement utilisé par certains est que l’État n’a pas pris l’intégralité des risques correspondants à cette rentabilité, puisqu’il a limité sa part au paiement du capital initial, avec les réserves mentionnées plus haut. C’est l’actionnaire qui a fait le travail. On peut répondre à cela que l’actionnaire minoritaire n’a pas non plus fait le travail. De plus, l’État assume d’autres dépenses qui profitent gratuitement à l’entreprise (infrastructure, sécurité…) et, très souvent, la capacité d’une entreprise à faire des surprofits tient à ce que le secteur dans lequel elle opère comporte des régulations qui limitent la libre-entrée des concurrents (communication, santé, finance…) à des fins utiles à la société dans son ensemble mais qui ont des retombées favorables aux entreprises déjà en place.
Dans la pratique courante de l’évaluation d’entreprise, on évalue l’entreprise en actualisant le profit après IS par ce que les praticiens appellent le « coût du capital ». Ce dernier est estimé comme le rendement obtenu sur les marchés financiers par des actionnaires pour des actifs de risque comparable. Il est calculé avant impôt personnel de l’actionnaire mais après l’IS payé par l’entreprise[3].
En microéconomie, on raisonne plutôt en termes de « coût d’usage du capital » pour calculer la valeur de l’entreprise. Ce dernier ajoute au taux de rendement obtenu sur les marchés l’impôt subi par l’entreprise et le taux d’usure ou d’amortissement du capital (en effet, on raisonne en valeur ajoutée brute s’agissant de la production de l’entreprise ou en EBITDA s’agissant de la part revenant au facteur capital).
Le résultat est en principe le même. Formellement, posons M’espérance de « marge » ou EBIT de l’entreprise, t le taux de l’impôt et enfin r le rendement du capital après IS sur les marchés financiers. Si la croissance est nulle, la valeur de l’entreprise est V= M (1 – t) / r dans un cas (praticien évaluateur) et V= M / r (1 – t) (microéconomiste).
[1] En France, le report est à durée indéterminée, mais il est freiné dans son rythme puisqu’on ne peut le reporter qu’à hauteur de 60% du profit de l’année. C’est une mauvaise mesure, nous le verrons.
[2] Les taux français effectifs aujourd’hui seraient de 29% – et à terme de 25% pour l’IS – et de 30% pour les revenus financiers.
[3] Les charges sociales correspondent à des prestations dans le futur et qui donc ne sont pas vraiment des « impôts ». Si ces sommes étaient mises dans des fonds de pension, on ne les compterait pas comme des impôts.
[4] Alan J. Auerbach, 2010, A Modern Corporate Tax, University of California, Berkeley, December. Cette proposition a été défendue au Congrès étatsunien lors des discussions autour de la réforme fiscale de 2017, pour être finalement rejetée.
[5] Il s’agit comptablement de la marge opérationnelle (ou EBITDA) dont on ôte l’investissement en capital fixe et circulant. C’est en gros le montant de ressources liquides qu’on peut extraire de l’entreprise une fois qu’elle a assuré ses besoins de croissance.
[6] En France comme dans d’autres pays sous forme différente, une bonne mesure a été un plafond mis à la déductibilité des frais financiers.
[7] L’État ferait quand même un surprofit, puisque son propre coût de financement, assimilable au coût des ressources pour le secteur public, est inférieur à 10%.
[8] Il faut comme condition supplémentaire qu’elle soit à rendements d’échelle constants.
[9] En toute rigueur, ceci ne vaut que pour une entreprise non endettée qui connait une croissance nulle : son flux net de trésorerie est égal à son profit comptable. Mais le raisonnement garde sa validité.







