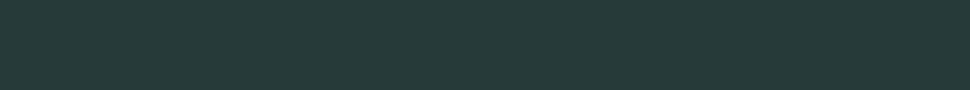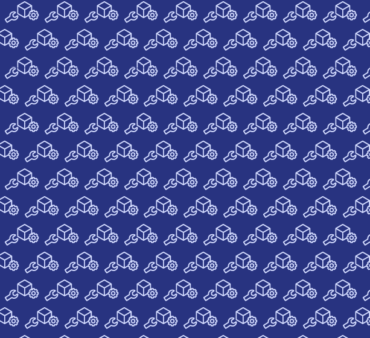L’importance de l’interopérabilité entre les plateformes Internet
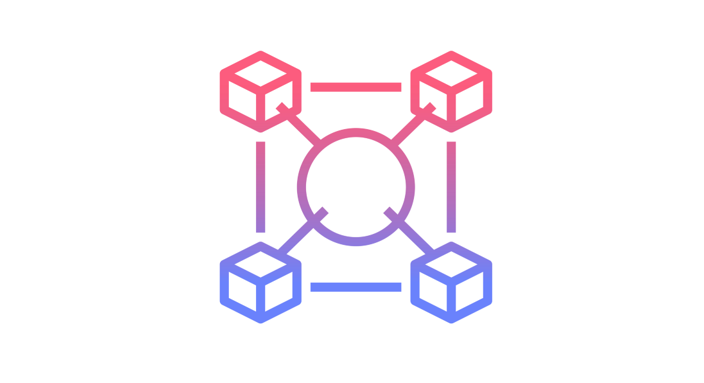
La manière dont Elon Musk prend le contrôle de Twitter peut poser problème à l’utilisateur, mais ce dernier se retrouve souvent sans choix s’il souhaite quitter cette plateforme. En effet, le marché est dominé par un étroit oligopole, rendant extrêmement difficile l’entrée de nouveaux acteurs. De nos jours, la géopolitique joue même un rôle majeur, avec des plateformes comme Vkontakte pour la Russie, Weibo pour la Chine, et quelques autres dans le monde occidental. Cela soulève des questions sur la façon dont l’information serait traitée en cas de monopole mondial de Vkontakte, ainsi que sur la manière dont le public chinois accède à l’information aujourd’hui.
On sait que ce pouvoir de marché tient à d’énormes effets d’échelle et d’envergure : les biens numériques nécessitent un coût fixe au départ et peu de coûts variables. Le coût unitaire moyen diminue donc lorsque les ventes s’accroissent. Un nouveau venu n’a pas de place pour mordre la rente de l’acteur dominant s’il part avec une clientèle réduite. Et s’il vient avec une avancée technique majeure, il se voit offrir le rachat. Par ailleurs, la taille accroît la masse des informations collectées et donc la qualité et le nombre des services annexes qu’il est possible d’offrir. Ajoutons à cela l’aisance avec laquelle une plateforme peut se développer à l’international. Pour les biens matériels, il y a des coûts de transport et des coûts commerciaux qui freinent la mondialisation du produit et laisse le temps à des concurrents de prendre racine sur le marché. Ces coûts sont bien plus réduits dans le cas du numérique.
Dans un papier intéressant, Luigi Zingales préconise une mesure simple pour accroître fortement le niveau de concurrence : imposer l’interopérabilité des plateformes. C’est exactement le problème de concurrence et la solution qui s’était imposée il y a un peu plus d’un siècle avec les opérateurs de téléphone. On a de la peine à l’imaginer aujourd’hui, mais l’usager était prisonnier de son opérateur. C’est comme si aujourd’hui un client de Orange ne pouvait pas appeler son correspondant s’il est chez SFR. Une telle situation ferait probablement émerger un gagnant qui absorberait l’ensemble du marché. La solution la plus fréquente à laquelle on était parvenu à l’époque était la nationalisation du réseau pour garantir que le monopole soit bienveillant en matière tarifaire. Cette solution n’est plus possible sachant le caractère transnational du marché, de sorte qu’il faut des solutions qui limitent le pouvoir de marché des acteurs et permette leur contestation par des nouveaux venus s’ils viennent avec une solution compétitive. La mesure la plus simple, et la plus efficace pour le client, c’est l’interopérabilité entre réseaux : un usager WhatsApp pourrait appeler un usager Signal ou Telegram ; un usager Instagram pourrait envoyer ses photos à un usager TikTok. L’interopérabilité ne concerne pas que les réseaux sociaux. On peut imaginer l’imposer également pour les services VTC du type Uber, Lyft ou G7. Le client demanderait son taxi, le plus proche répondrait quel que soit son réseau d’appartenance.
L’interopérabilité est relativement facile à mettre en place. Le régulateur peut imposer la mise en place par l’industrie d’interfaces entre opérateurs ou mieux une procédure d’entrée-sortie commune. C’est exactement ce que l’Union européenne avec sa directive sur les services de paiement : un standard ouvert par lesquels un opérateur peut directement accéder aux données du compte bancaire du client, avec son autorisation.
Si la solution technique existe, on devine que l’obstacle administratif et politique est un Himalaya. Le pouvoir de lobby de ces grands opérateurs est énorme. La dimension géopolitique intervient aussi. Il n’est pas sûr par exemple que les États-Unis veuillent aller au-delà d’un contrôle minimal de la concurrence sachant que les grands réseaux dans le monde occidental sont tous étatsuniens.
Mais c’est une idée qui doit faire son chemin dans l’opinion. Après tout, le lobby bancaire, très puissant, a dû accepter quelques réformes importantes.
Cet article a été initialement publié sur Vox-Fi le 10 janvier 2023.