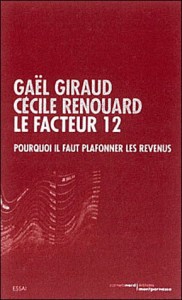Réduire l’inégalité des revenus – Lecture du « Facteur 12 »

Lu pour vous : Le facteur 12. Pourquoi il faut plafonner les revenus ? – Gaël Giraud et Cécile Renouard – Carnets Nord – 2012
Les inégalités s’accroissent violemment. C’est vrai pour les revenus, même si la France a été un peu à l’écart de ce mouvement jusque-là ; c’est plus vrai encore pour les patrimoines, y compris en France avec l’explosion des prix de l’immobilier. Le phénomène porte un ferment d’instabilité et de rupture sociale, d’autant que la croissance économique, nulle ou très faible sur les années à venir, ne sera plus là pour redistribuer en cascade du revenu ou de l’activité sur les catégories sociales défavorisées. S’incrustant durablement dans nos sociétés, le phénomène recrée des formes de castes, avec des mécanismes de reproduction interne qui figent la structure sociale et rendent vain l’idéal démocratique.
C’est le sujet qu’abordent Gaël Giraud et Cécile Renouard dans leur nouvel ouvrage commun. Facteur 12 est le nom du programme qu’ils défendent : les hauts revenus ne doivent pas dépasser de 12 fois les plus bas. Dans la durée, ce rétrécissement des revenus perçus assurera aussi un rétrécissement de l’échelle des patrimoines. Pourquoi cette mesure et comment la mettre en place ?
Les auteurs donnent une raison positive – elle s’impose parce que l’inégalité est socialement nocive – et deux négatives. La première raison est qu’à réduire l’éventail des revenus, il est faux qu’on provoque un exode des talents et des riches hors des frontières ; la seconde est qu’il est faux qu’on réduise les incitations à travailler et à créer de la richesse des plus talentueux. La croissance économique d’il y a trente ans était tout aussi, sinon plus dynamique qu’aujourd’hui et les cadres et dirigeants de l’époque tout aussi, sinon plus appliqués dans leur travail et leurs performances. C’était la société dans son ensemble qui se satisfaisait d’une échelle des revenus bien plus resserrée pour fonctionner. L’échelle des revenus allait de 1 à 8 dans la Suède d’après-guerre et le corps social s’en accommodait, les questions de statut, notamment par l’argent, fonctionnant autant qu’aujourd’hui, mais à un coût économique et social, c’est-à-dire à des niveaux d’écarts salariaux, bien moindres. Les auteurs s’élèvent à ce propos contre un courant de pensée devenu très influent aujourd’hui en économie, à savoir la théorie des incitations ou des contrats optimaux, qui selon eux ne met l’accent que sur la récompense individuelle pour expliquer la performance. On est payé cher, parce qu’on le vaut bien. C’est en effet oublier à quel point la performance s’accomplit au sein d’un groupe, par un travail collectif, de sorte que les incitations doivent tout autant être collectives (leadership, sentiment d’appartenance, égalité de traitement…) qu’individuelles.
L’argument porte. On dit que George Best, attaquant du Manchester United dans les années 60 et certainement un des meilleurs footballeurs de tous les temps, recevait quand il se déplaçait ses deux livres de compensation et devait assumer pour le reste tous les autres frais, dont des nuits dans des hôtels modestes, comme le reste de l’équipe. Il s’en accommodait. Il jouait avec la même implication qu’un joueur d’aujourd’hui, qui pourtant gagne peut-être mille fois plus que lui. Peut-être même était-il plus motivé que les stars, gavées au bonus, qu’on recrute ces temps-ci dans l’équipe de France.
Une incidente ici pour dire que les auteurs ont tort de brocarder de la théorie des incitations. Elle établit un cadre très large, propre à intégrer aussi la dimension collective dans la performance – au prix il est vrai d’une formalisation plus complexe. On fait référence ici aux travaux d’Akerlof (voir sa tribune dans ce Blog), qui est un des fondateurs de ce courant de pensée, ou de Tirole, mentionné également dans le Blog).
Sur le comment, les auteurs sont assez sages. Ils partagent le point de vue dominant des économistes (et pourtant sujet à débat) qu’il est préférable de traiter séparément les sujets de distribution de la richesse et de sa production. Autrement dit, accepter le jeu de l’équilibre économique au niveau de l’entreprise, mais en corriger les effets jugés socialement néfastes par une politique de redistribution, dans ce cas principalement fiscale. Ils mentionnent aussi, pour la bonne cause, des règles accrues de transparence sur les revenus. Ils vont dans le sens de Piketty et de beaucoup, consistant à retrouver des impositions franchement plus progressives sur les revenus. Ils refusent, sauf exception, une entreprise aidée par la puissance publique, une intervention directe sur la politique salariale des entreprises, leur imposant la règle du 1 à 12. Un détail à ce sujet, les auteurs indiquent que la fixation d’une telle fourchette est vertueuse pour les bas revenus : les personnes en haut de l’échelle ne peuvent espérer faire progresser leur niveau de revenu en euro que si les bas revenus progressent eux-aussi. Oui, mais si le facteur 12 est mis en place via la fiscalité, c’est-à-dire ne s’observe qu’après ponction fiscale, on perd cet élément d’incitation directe. Il faudrait pour cela que le facteur 12 soit directement imposé aux dirigeants d’entreprise en charge de la fixation des salaires.
Peut-être aussi les auteurs pourraient davantage s’attarder sur l’impôt sur le capital, au-delà de la reprise de l’idée de Delpla d’éponger en une fois de la dette nationale par un grand impôt sur les patrimoines payables en nature. Dans un monde sans concurrence fiscale, il a plutôt quelques bonnes propriétés, comme l’indique ce post du Blog.
Malgré, ou plutôt à cause de l’importance du sujet, deux raisons font que l’on fini déçus la lecture de l’ouvrage.
D’abord en raison d’une certaine dispersion du livre qui traite de sujets dont le lien avec le facteur 12 est pour le moins ténu. Ainsi tous les développements sur la crise d’endettement de nos économies : certes, les créanciers se retrouvent plutôt du côté des hauts revenus et les débiteurs de l’autre côté, mais la vérité est que les bas revenus sont exclus de l’accès à l’endettement. De même, lassent les longs passages sur l’économie verte et la préservation des ressources rares, fortement inspirés de l’excellent Jancovici. Oui, les bas revenus souffrent plus que proportionnellement de la hausse du coût de l’énergie, poste qui pèse davantage dans leur budget. Mais est-ce au cœur du sujet ?
La seconde raison est plus embêtante. Au lieu des investigations annexes du livre, on aurait souhaité qu’il fouille véritablement les facteurs à l’origine de la dispersion croissante des revenus. Il n’y a pas de politique correctrice sans bonne compréhension du phénomène.
On sait que cela tourne autour de trois facteurs : économie de la connaissance, qui laisse en chemin beaucoup de personnes non qualifiées ; mondialisation qui met en concurrence le travail peu ou non qualifié des pays émergents avec celui des pays développés, que ce soit de façon directe par transfert de capitaux vers ces pays ; ou indirecte via le commerce extérieur, les biens exportés par les nouveaux pays industriels étant plutôt riches en main-d’œuvre et ceux exportés par les économies développées en étant plutôt pauvres ; et, dernier facteur, défaillance criante des marchés, notamment ç cause de la présence de rentes, de monopoles, de passe-droits, de collusion. Pour avoir un peu regardé l’industrie de la finance, j’ai le sentiment que c’est ce dernier facteur qui y domine. Participe également aux phénomènes de défaillance de marché – et, au passage, de régulation– le dysfonctionnement complet du marché de l’immobilier, qui fait qu’on organise systématiquement une rareté propre à une flambée des prix dans les grandes métropoles internationales, particulièrement en région parisienne.
Si on montre que l’effet connaissance et formation est décisif (cela semble être le cas), une recommandation de politique économique est d’investir massivement dans l’éducation, qui a le double effet, de permettre d’obtenir des emplois mieux rémunérés ; de donner aux gens la conscience du caractère intolérable pour la société de se satisfaire d’une telle dispersion des patrimoines. Comment mettre cela en place ? Le facteur 12 est-il nécessaire ou en serait-il la résultante?
Si ce sont des situations de rente et de collusion qu’il faut affronter, peut-être la solution n’est-elle pas de s’orienter vers toujours moins de marché, mais dans certains cas vers plus de marché et de concurrence pour attaquer la rente. Et une régulation qui s’appuie intelligemment sur les mécanismes de marché pour en circonvenir les effets pervers. C’est manifeste dans le cas de l’industrie bancaire ; manifeste dans le cas de l’industrie du spectacle ; manifeste aussi dans le cas du marché immobilier où il faut dégeler l’offre foncière et mieux valoriser certains sites urbains et moins d’autres.
La mondialisation manifestement joue aussi son rôle. Elle pose pour nos sociétés la question du travail non qualifié, notamment masculin, à la fois évincé par la machine et par les importations, tant des biens que du travail, via l’immigration. Pour autant, la fermeture des frontières, hautement préconisée dans l’ouvrage, est-elle la solution ? L’Allemagne, à cause des mécanismes imparfaits de la zone euro, fait certainement plus de mal aujourd’hui à l’industrie française que la Chine. Par exemple, elle est en train d’évincer peu à peu toute l’industrie automobile française, par des avantages de compétitivité injustifiés qui s’ajoutent à ses avantages propres. Devra-t-on fermer nos frontières avec l’Allemagne ?
Ainsi, il faut se demander pourquoi un ouvrage consacré à la réduction de l’éventail des revenus et rédigé par deux économistes très informés, ne traite au fond que négligemment et incidemment des causes de cet éventail ? J’explique cela par une posture idéologique erronée. Pour eux, il n’y a pas de justification analytique à cette dispersion des revenus (p. 230). Ils prennent le mot de justification dans son sens normatif, mais l’étendent aussi à son sens positif d’explication d’un phénomène. Au fond, la dispersion des revenus ne s’explique pas par pur postulat agnostique. Et pourquoi cela ? Parce que, selon eux, une économie de marché n’est pas en mesure de faire fonctionner un vrai marché. Ils partent de l’exemple des marchés financiers, pour en déduire qu’ils ne fonctionnent que comme pure loterie, pur mécanisme aléatoire, aussi erratiques que le sont les tâches qui apparaissent sur le soleil. Forts de cet exemple (lui-même très discutable), ils généralisent à tous les marchés, qui ne seraient, eux aussi, que de simples marches aléatoires, donc étrangers à l’entendement. Le marché du travail n’échappe à cette malédiction qu’en raison de sa forte régulation. Laissé à lui-même, il serait tout autant erratique. L’argument est curieux : il fait fi du fait que les régulations diffèrent complètement d’un pays à l’autre. Le compliment fait à la régulation est même à double tranchant. Si avec les régulations en place, les résultats en matière de distribution de revenus sont ceux qu’on observe, elles sont diablement inefficaces et le sont de plus en plus, sachant qu’au temps des marchés du travail bien moins régulés d’autrefois, les écarts de revenus étaient moindres.
Si le phénomène existe, il doit être soumis à une analyse positive. Il doit être expliqué, c’est le difficile travail de l’économiste de chercher à le faire, et sur cette base, trouver les politiques correctrices à mettre indispensablement en place. Dans l’intervalle, et ici on rejoint inopinément les auteurs, il faut, pour la qualité du pacte social, revenir sur le détricotage systématique, opéré au cours des deux dernières décennies, des mécanismes de progressivité fiscale.