Sur les contrarians en économie. Plaidoyer pour les « idées reçues »
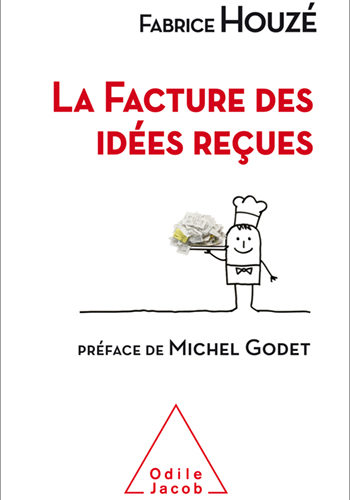
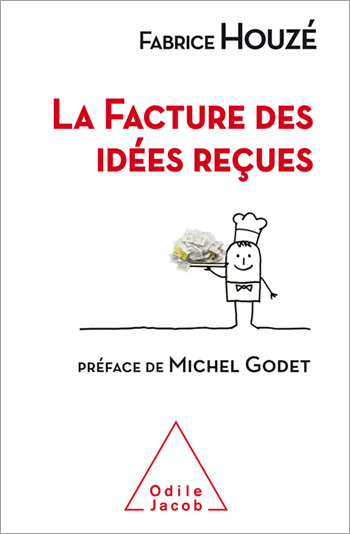 Lecture de « La facture des idées reçues » par Fabrice Houzé (éditions Odile Jacob, 2017)
Lecture de « La facture des idées reçues » par Fabrice Houzé (éditions Odile Jacob, 2017)
De toutes les disciplines intellectuelles, c’est l’économie qui fait le plus éclore les vocations de « contrarians », pour retenir ce mot venu des marchés financiers. Un économiste contrarian, c’est un économiste qui prend à revers les idées dominantes, en général celles mises en avant par les non-économistes ou par les politiques, celles « qui font consensus ». C’est un économiste qui joue contre la tendance, un peu comme sait le faire un trader sur les marchés.
Fabrice Houzé est un économiste contrarian (en plus d’avoir une expérience de trader) et, je me dépêche de dire, un contrarian de très bonne facture, pour faire le jeu de mots avec le titre de son livre. Il est contrarian à l’égal, bien que plus jeune, de Michel Godet qui préface son livre, ou de Jacques Delpla, ou de Rémy Prud’homme pour citer trois économistes toujours à l’affut de solutions de marché aux questions sociales ouvertes. La critique que je fais ici de son livre adopte elle aussi le mode contrarian, j’espère de bonne facture.
Mais avant cela, un peu plus sur les contrarians et les idées reçues, c’est le titre qui m’y pousse.
Ce qu’est un contrarian
Un contrarian se doit d’être contrariant, c’est-à-dire un peu agaçant, et même fâcheux. L’économie est une discipline qui se prête à merveille aux contrarians, puisque les phénomènes sociaux sont toujours interdépendants, la cause pouvant devenir conséquence, et inversement. Tout est dans tout et réciproquement. De sorte qu’avec un esprit affuté, une bonne culture économique (comme l’a visiblement Fabrice Houzé) et quelques tours de rhétorique, il est toujours possible d’attaquer l’idée dominante, de faire peser sur elle le soupçon du doute. En fait, l’économie est la casuistique des temps modernes, celle qui permet de mettre un discours circonstancié sur à peu près tout.
Je dis aussi d’emblée – on le verra à l’occasion de ce livre – qu’un contrarian est souvent utile, parce qu’au fond, c’est le propre de la démarche scientifique de s’opposer, de ne pas être d’accord, de « chercher la petite bête ». Tout intellectuel – et d’ailleurs chacun de nous – a au fond de lui un côté contrarian, le poussant à ne pas admettre avant d’avoir touché du doigt, un saint Thomas de la preuve scientifique, le scepticisme étant le levier de la découverte. C’est donc une première catégorie, celle du contrarian-débusqueur, du type fact- ou idea-checking.
Mais qui n’a rencontré – ou joué le rôle – dans un dîner entre amis, de celui qui soutiendra mordicus une thèse repoussoir, pour le plaisir assez pervers d’animer la soirée. Il lancera par exemple que la traite des esclaves conduite par l’Occident n’était pas si effroyable que cela. Pour être précis, il se gardera de le dire ainsi, il soutiendra plutôt, sous forme indirecte, que la traite à destination du monde islamique était pire encore, ce qui, en creux, atténue l’indignation à propos de l’autre traite. Je prends cet exemple parce que Fabrice Houzé l’évoque à peu près dans ces termes. Mais il a ici de grands prédécesseurs : Marx était un contrarian, qui soutenait que l’esclave sur les plantations de Virginie était bien mieux traité que l’ouvrier du textile à Manchester. (Comme toujours, à contrarian, contrarian et demi. Il y a maintenant des études qui montrent que le sort de l’ouvrier de Manchester, contrairement à la description effroyable qu’en faisait Engels, était certainement meilleur que celui du paysan ou yeoman de l’époque, et donc pas si mauvaise que ça, pour ne pas dire… bonne au final !)
Il y a la variante réactionnaire ou anarchiste de droite chez le contrarian, très fréquente chez les économistes, notamment les libertariens, celle que dénonçait avec humour et talent Albert Hirschman dans un célèbre livre[1]. Elle va ainsi : « Ah ! vous préconisez cette mesure (en général d’aide sociale) ! Comme c’est généreux ! Mais, mon bon ami, si vous preniez en compte ceci et cela, vous aboutiriez à l’effet exactement inverse. Votre générosité se retourne contre sa cible, c’est très dommage ! » L’enfer est donc pavé de bonnes intentions, argument toujours efficace que certains esprits malicieux adorent retourner en : « Le paradis est pavé de mauvaises intentions ! ». C’est de l’égoïsme du boucher et du boulanger que vous tirez votre viande et votre pain, pas de leur générosité, c’est bien connu, stupid !
Celui-là pourtant pourrait méditer ce mot de Paul Samuelson, ce grand économiste : « une bonne cause vaut bien un peu d’inefficacité », rappelant ainsi ces gens à plus de modestie.
Je m’abstiens de parler ici de cette variante, plus rare et peu sympathique, du contrarian négationniste, de celui qui se complait dans le regard narcissique de son courage dissident. (Voyez, j’adopte ici un truc rhétorique cher au contrarian : la prétérition, consistant à dire qu’on ne parle pas d’une chose, pour en fait en parler !) Ou alors, dans un mode cocasse, du contrarian-gourou, qu’on rencontre chez certains économistes de banque, ceux dont le métier est de faire de la prévision conjoncturelle pour, disent-ils, « guider les marchés ». On parie très fort et de façon répétée sur un événement très rare, mais catastrophique. Comme de miser sans arrêt sur le « 36 » au jeu de la roulette (la mise ne coûte pas cher, n’étant que de l’encre sur du papier !). Si l’événement ne se produit pas, on met son mouchoir dessus et on oublie ; s’il advient, on ramasse le gros lot : « voyez ! je vous l’avais bien dit ! ». Combien d’économistes se targuent ainsi d’avoir prévu la crise financière de 2007 ! Comme le veut la blague, des trois chutes récentes du dollar, ils en ont correctement prévu dix.
Très fréquente aussi la variante « anti-pensée unique » du contrarian. Il s’agit d’une figure de style assez commode consistant à discréditer la thèse adverse uniquement par le fait qu’elle est partagée par tous, sauf bien-sûr par un MOI superbe, juché sur son surplomb d’économiste. Or, on a le droit de le dire : il y a de la bonne pensée unique, il y a de bonnes « idées reçues ». Assez de cette pensée unique anti-pensée unique ! On s’aperçoit vite que les incendiaires de la dite « pensée unique », qui se disent persécutés et soumis à l’opprobre de la majorité, composent en fait une assez nombreuse légion, celle des gens qui savent capter l’attention des médias, qui font les talk-shows du soir dans les radios, alors qu’ils ne font au total que propager leur propre pensée unique, pas toujours du meilleur niveau. Flaubert était de ceux-là, je le dis : à coup sûr un des plus grands romanciers en langue française, sinon le plus grand, mais fieffé réactionnaire, comme le montre son « dictionnaire des idées reçues ».
Un signe qui ne trompe pas : un contrarian du type « anti-idées reçues » présente souvent son discours comme étant ni de droite ni de gauche. C’est ce que fait Fabrice Houzé dans son livre : il le conclue par une comptabilité précise en deux colonnes des mesures qu’il préconise : « de droite » et « de gauche ». Il n’hésite pas à convoquer – vieille ficelle rhétorique là encore – des économistes de gauche qui, comme lui, disent la même chose. « Voyez ! Krugman, très à gauche, dit ceci, tout comme moi ! » ou : « Voyez, Terra Nova, un think tank classé à gauche, dit cela, tout comme moi ! ». Curieux ! il ne dira jamais : « Voyez ! même Friedman ou Hayek ou Pascal Salin disent ceci, et pourtant ils sont de droite ! ». Y aurait-il une vérité dans la parole d’Alain pour qui se dire ni de droite ni de gauche est l’indice qu’on est de droite.
Je ne peux finir ce tour d’horizon sans évoquer les économistes contrarians « de gauche », ceux qui se désignent du nom d’« hétérodoxes », courageux David face au Goliath qu’est le « mainstream » universitaire en économie. Ils se targuent d’être les seuls à ne pas se plier au moule de l’économie quantitative, de l’individualisme méthodologique, d’être seuls capables de faire la synthèse de la sociologie, de la philosophie et de l’histoire, et d’avoir le droit de convoquer René Girard ou Spinoza dans une déconstruction de l’idée dominante. C’est une position un peu hautaine, qui nie l’extraordinaire variété des idées économiques du mainstream, qui fait peu de cas des recherches empiriques et qui, au final, oublie que tout économiste, s’il veut laisser sa marque, a tout autant intérêt à se conformer à une école dominante qu’à se singulariser. À leur défense, il faut reconnaître que l’arrivée massive de l’anglais et des maths comme langues de communication en économie, et des revues à jury comme médias pour se faire connaître, a quelque peu « disrupté » la profession d’économiste, pour prendre un mot à la mode.
Un essai à l’américaine
Ce long préambule pour aborder le livre de Fabrice Houzé. Il s’agit d’un essai pour grand public, sous une forme qu’on voit davantage chez les auteurs anglosaxons que chez nous, l’habitude étant là-bas pour les universitaires reconnus d’écrire des ouvrages grand public très documentés. Pas d’un essai « à la française », du genre Alain Minc si vous voyez ce que je veux dire. Il y a dans le livre de Houzé, qui n’est pourtant pas de tradition universitaire, tout un appareil documentaire, de citations, de références, etc., d’appuis dans la littérature académique, le tout mis en fin d’ouvrage pour ne pas bloquer la lecture. Et non, comme trop souvent, le seul verbe haut en guise de preuve et d’affirmation. Au total, un travail considérable. Il est publié chez Odile Jacob, éditeur qui en général garantit une certaine solidité éditoriale et la qualité du style, rendant le livre très agréable à lire.
Alors oui, c’est pour moi son petit défaut, il est par moments sur le mauvais versant du style contrarian. Mais je l’ai déjà dit.
Dans une quinzaine de chapitres, il passe en revue certaines idées reçues et s’attache donc à les déconstruire, à montrer à quel point elles coûtent à l’économie et à la société. Son premier chapitre ne peut qu’attirer ma sympathie et est en fait la clé dans tout son argumentaire : il faut supprimer les brevets. Il se repose sur le remarquable livre de Michele Boldrin et David Levine « Against Intellectual Monopoly » (ici pour la version internet pdf), que tout le monde devrait lire, surtout dans notre société de jour en jour plus « numérique » et immatérielle, un bouquin qu’Odile Jacob devrait traduire et publier. Et mettre gratuitement sur Internet, ainsi que le livre de Fabrice Houzé, pour montrer qu’elle milite en action contre la propriété intellectuelle des auteurs. Il y a effectivement une tension entre un droit exclusif d’usage pour inciter à la création, et un besoin de concurrence pour limiter les rentes et favoriser la création d’autrui. Un brevet ou un droit d’auteur est une forme de monopole. Quel équilibre trouver ? Pas facile. Et pas facile de supprimer – ou même de réduire drastiquement, comme Fabrice Houzé l’indique au final – les durées d’exclusivité. Jean Tirole est un défenseur du système des brevets et pourtant conclut exactement comme Houzé qu’il faut en réduire la durée. Elon Musk, patron entre autres de Tesla, est sur la même ligne. Voici donc une « idée reçue » qui commence à être mal en point si un prix Nobel ou un grand fondateur industriel la critiquent tout autant, en font une « idée reçue » adverse.
Ainsi vont d’autres chapitres, toujours sous une armature « libérale » : il est évidemment de bon sens pour tout économiste d’affirmer les effets pervers (ch. 8) de la prohibition du cannabis, d’affirmer l’absurdité du refus d’un calcul économique sur la santé (ch. 7) ou sur l’environnement (ch. 2) ; qu’on ne peut exiger des pays moins avancés d’avoir les standards des pays avancés en matière de droits sociaux (ch. 4), sauf à imposer une forme assez perverse de protectionnisme, un thème qui est au cœur du débat sur l’Europe sociale et sur la question des détachés aujourd’hui. Mais si on retient ce dernier thème, il y a une façon « contrarian », genre dîner arrosé entre amis, de le dire. Il suffit d’intituler le chapitre : « Laissons les enfants travailler dans les pays pauvres », ce qui, au-delà du couvert provoquant, est une stupidité : les pays moins avancés bénéficient aussi de ces normes importées, ce sont des leviers pour bouger plus rapidement et plus efficacement leurs sociétés. C’est d’ailleurs un des très bons arguments (Tirole le met en avant) pour justifier la RSE, la responsabilité sociale de l’entreprise : on est davantage capable en tant qu’individu de faire avancer une cause en pesant sur le producteur, à savoir l’entreprise, que comme consommateur. Et les élites libérales de ces pays s’en réjouissent et appellent même de leur vœu cette confrontation internationale, y compris sur le plan des normes éthiques. Il n’y a pas que la technologie ou le capital qui doit passer les frontières. C’est tout le débat, pour revenir au chapitre 2 sur l’environnement, des accords de Paris : oui, les pays émergents doivent intérioriser aussi – dans leur propre avantage – les normes environnementales mondiales, bien-sûr en négociant au mieux les compensations à avoir. Ils ne sont pas condamnés à mettre en avant leur laxisme environnemental pour se spécialiser dans l’industrie de recyclage low cost des déchets, l’équivalent environnemental du travail des enfants.
Bernard Manin consacre un des plus géniaux bouquins de sciences politiques à la question de la représentation démocratique (« Principes du gouvernement représentatif », Calmann-Lévy, 1995) : faut-il de la démocratie indirecte via des députés ? comment les élire, notamment par tirage au sort comme dans la démocratie athénienne ? etc. Une très longue discussion sur l’histoire et le « pour et contre » de ce dernier sujet. Dans un chapitre très court (ch. 12, « Élections, même le hasard fait mieux »), Houzé se fait l’avocat du tirage au sort. Pourquoi pas, bien qu’on quitte ici le strict domaine économique ? Mais on a le sentiment du trop ou pas assez, car le sujet ne s’expédie pas en 10 pages seulement. Il en va ainsi du système des vouchers, pour l’éducation nationale (ch. 11). L’idée : vous recevez un chèque de la part de l’État pour pouvoir mettre votre enfant là où il vous plait, y compris dans les écoles davantage huppées ! Et tant pis, ou plutôt tant mieux, pour les écoles qui ne savent pas attirer le chaland : cela les pousse à s’améliorer. Tout ce court chapitre part d’une analyse bien documentée des maux de l’école française, à la fois républicaine et élitiste, dont le modèle semble sacrément grippé aujourd’hui. Mais, expédiée en deux pages à la fin, vient cette idée très controversée des vouchers, au passage une proposition sacrément « idée reçue », puisqu’elle est dans la besace de tous les libertariens américains, et rarement mis en place sauf sous la forme de nos bonnes vieilles bourses. Au fait, soyons plus contrarians encore : pourquoi ne pas rendre négociables sur un marché ces vouchers ou chèques éducation ? Pourquoi la famille qui persiste à mettre son enfant dans le (mauvais) collège à côté, forcément moins cher puisque mauvais, n’aurait-elle pas le droit d’empocher sa renonciation à mettre son enfant à Saint-Jean de Passy ? Pour la petite histoire et en quittant un peu notre sujet, c’est un système de vouchers qui, avec l’aval intellectuel de quelques économistes américains, a été mis en place à la fin de l’époque communiste en Russie : tous les grands combinats nationaux ont été « distribués » à l’ensemble de la population sous forme de vouchers, avec droits de cession. Pour bien-sûr se retrouver très vite dans les mains de quelques agioteurs.
Je veux m’attarder sur un thème, couvert par les chapitres 3 et 4, qui chiffonne toujours un peu, celui de l’inégalité croissante de nos sociétés, attestée par la plupart des statistiques. Ce sont, dit pour simplifier, deux chapitres « anti-Piketty » : ils ne nient en aucun cas le phénomène, mais qui contestent la lecture qu’on en fait. L’idée avancée semble là encore de bon sens. Elle se décline en deux temps. On n’aurait le droit de fustiger les gigariches (selon son expression heureuse) que s’il s’agit d’une population abritée et retranchée, se reproduisant à l’identique, protégée par des rentes. Or, selon l’auteur, il s’agit largement d’une population très mouvante, notamment d’entrepreneurs qui, par chance ou talent ou les deux, ont réussi à créer une valeur industrielle, souvent très utile socialement. Je renvoie ici à un article de qualité, que ne cite pas l’auteur, qui argumente fortement en ce sens : « Defending the One Percent », par Gregory Mankiw. Mais aussi à cet article d’un groupe d’économistes réputés qui montrent que, malgré le fort turnover dans la population des entrepreneurs à succès, la société américaine semble depuis quelques décennies s’enkyster davantage, avec une élite qui se reproduit au sommet : « The Fading American Dream: Trends in Absolute Income Mobility since 1940 », Chetty et alii, 2017.
Quoi qu’il en soit, vient le deuxième temps du propos, qui nous ramène au chapitre sur la propriété intellectuelle : si on veut limiter les gigantesques rentes dont jouissent en effet ces fameux 1% au sommet des revenus et des patrimoines, la solution est : plus de concurrence, plus de concurrence encore et moins de rente. Et de donner l’exemple de Xavier Niel, qui en cassant les marges d’oligopole dans la téléphonie mobile, a certainement davantage distribué de pouvoir d’achat aux bas-revenus que la taxation à 75% des revenus les plus élevés mis en avant dans le fameux discours « j’ai un seul ennemi, la finance » du candidat François Hollande. J’adhère à cette thèse, mais constate tout autant la difficulté de sa mise en pratique, voire sa simple inefficacité. Il n’y a pas ou quasiment pas de droit de propriété intellectuelle pour les plateformes du numérique. Instagram n’a aucun problème pour copier Snapchat. Jeff Bezos avait voulu breveter sa solution ergonomique du « one click » et le régulateur américain, pourtant toujours très conciliant dès qu’il s’agit de faire admettre un brevet (il y en a plus de 400.000 par an ! On se demande comment il a le temps de tous les examiner !), avait quand même à la fin retoqué l’idée.
C’est donc très compliqué de promouvoir la concurrence pour des biens ou des produits où la collusion ou la domination se déclinent de façon insidieuse, c’est-à-dire quand le marché fonctionne mal, ce qui est précisément le cas où il est difficile d’avoir une bonne concurrence, une proposition qui n’est pas si tautologique qu’elle en a l’air. S’il en va ainsi, il faut peut-être rechercher des substituts, et dans ce cas, une « idée reçue » pas si sotte est peut-être d’utiliser la fiscalité comme outil de redistribution. L’auteur agonise l’idée de l’impôt sur la fortune, comme il est bon ton de le faire en France. Oui, le mettre en place dans un seul pays est, disons, meurtrier pour le pays qui le fait, en raison de la concurrence fiscale. Pour autant, c’est un impôt que de très nombreux économistes soutiennent, en raison de son bon caractère incitatif : il pousse à mettre le capital en usage, et non à le laisser en jachère ou à le mal gérer. Il a donc un débat à conduire sur les propriétés respectives d’un impôt sur le capital, qui joue un peu comme un taux d’intérêt sur une dette, et un impôt sur le revenu, qui frappe le flux et non le stock, un peu comme un dividende le fait sur les fonds propres ; mais un impôt qui a le défaut de favoriser celui qui ne fait aucun effort pour bien valoriser son capital, puisqu’alors il ne paie plus d’impôt. Un économiste comme Maurice Allais soutenait ardemment la taxation du capital, et pourtant, il s’agit d’un économiste de droite ! (Voyez, j’utilise le truc contrarian à mon tour !). Léon Walras aussi, un économiste de gauche.
Alors on dira : il est impossible de mettre en place une taxation sur le capital à l’échelle mondiale, ou du moins dans une grande zone comme l’Europe. Oui, c’est probablement vrai. Mais est-il beaucoup plus facile d’abolir les droits de propriété intellectuelle ou de mettre en place le revenu de base universel, comme l’auteur en fait la promotion dans le chapitre 5 ? L’irréalisme pratique serait un bon test d’« idée non-reçue » dans un cas, mais pas dans l’autre.
Je veux finir par du contrarian d’excellente qualité à mes yeux, celui qui couvre toute la fin du livre, les chapitres 13 à 15 sur la finance. Tout démarre d’un exposé scolaire mais très limpide sur comment fonctionne le crédit et la monnaie. Puis d’un développement sur la dette, comme principal agent pyromane dans les crises financières. Fabrice Houzé cite et s’appuie sur le génial bouquin de Adair Turner, « Reprendre le contrôle de la dette », Éditions de l’Atelier, 2017. Chapeau pour la qualité de l’exposé. Puis il développe avec talent la thèse d’un système monétaire dit « 100% monnaie », où la création monétaire ne serait plus l’apanage des banques privées, mais de la banque centrale. Là encore, une idée à rebrousse-poil, parfaitement exposée dans ce court essai de l’économiste John Cochrane (« Toward a run-free financial system », 2014, John H. Cochrane), mais une idée qui gagne en currency, comme disent les Anglais, c’est-à-dire qui circule tous les jours davantage, qui est en train de devenir, oh horreur !, idée reçue.
[1] Albert O. Hirschman, Deux siècles de rhétorique réactionnaire, Fayard, 1991.








Vos réactions
Article stimulant. Bravo !
Report comment