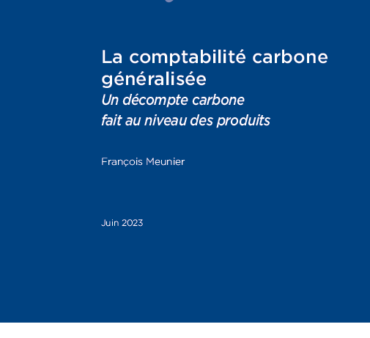Le modèle CARE : faire rentrer la soutenabilité dans les comptes

L’idée première du modèle CARE, celle d’une comptabilité en « triple capital » adaptée à la prise en compte de l’environnement, date de 1992 sous la plume de Robert Gray, un professeur de comptabilité écossais. En 2012, Jacques Richard et Alexandre Rambaud, à l’époque chercheurs associés à Paris-Dauphine, l’ont pleinement développée lui donnant le nom de CARE, pour Comptabilité Adaptée au Renouvellement de l’Environnement. Son objectif est d’ajouter à la comptabilité classique, celle qui enregistre les transactions monétaires d’une entité disposant d’un capital financier, deux des lettres de l’ESG, à savoir la prise en compte des ressources environnementales (E ci-après) et du capital humain au sens large (S). Ce modèle connait un développement continu, à la fois dans ses principes et dans le nombre, bien qu’encore réduit, des entreprises qui l’adoptent pour leur comptabilité extra-financière. De bonnes références sur CARE peuvent être trouvées ici et là.
On en fait ici une présentation critique. On développe le principe de base de CARE, puis les grandes étapes de la méthode – les praticiens de CARE en comptent huit, mais qui se ramènent à deux – l’une d’identification des cibles et de collecte des données, l’autre de leur mise en forme comptable. Nos commentaires sont en conclusion.
Principe
Tout activité productive apporte dommages et bénéfices à l’environnement naturel et social sans que ceux-ci soient nécessairement pris en compte dans les prix de marché. On parle d’externalités négatives, ou plus rarement positives, affectant l’environnement. Le capital humain est affecté en cas d’accidents du travail, de salaires exagérément bas, d’un travail abrutissant, etc. Le capital naturel se déprécie par la pollution, la dégradation des sols, la baisse de la diversité biologique, etc. Ces deux « capitaux » peuvent à l’inverse être améliorés par toute action d’atténuation, de préservation ou de réparation : la formation professionnelle ou la restauration de la qualité du sol pour prendre deux exemples. Omettre ces coûts ou ces avantages conduit en général à des décisions économiques mal fondées. Un distributeur (pour prendre un exemple tiré d’une présentation faite par un cadre de Carrefour sur la méthode CARE) pourrait trouver intérêt à vendre des carottes bio plutôt que des carottes non bio pourtant moins chères s’il prend en compte exhaustivement les coûts engendrés sur le capital naturel d’une agriculture non-bio. L’exploitant d’une carrière d’agrégats ne peut ignorer les coûts de restauration du site une fois l’exploitation terminée. À défaut, la nature est détériorée durablement.
La comptabilité traditionnelle ne prend pas en compte ces externalités et considère comme simples coûts ce que les ressources naturelles et le travail apportent à l’entreprise. Les salaires font partie des charges d’exploitation et cette charge sera moindre si le salaire baisse. L’usage d’un terrain pour exploitation occasionne un loyer et celui-ci rentre également dans ces charges. La comptabilité donne aujourd’hui une vision de l’entreprise où la mise en œuvre est intégralement le fait du capital financier. C’est lui qui crée la valeur financière, même s’il opère sous la contrainte de ne pas omettre les coûts contractuellement engendrés par l’activité. Certes, il existe une approche modernisée pour prendre en compte les coûts écologiques : s’agissant de la pollution par exemple, elle consisterait, à défaut d’un prix de marché, à imputer un prix notionnel qui représente le véritable coût social, de façon qu’il soit « internalisé » par l’entreprise, c’est-à-dire pris en compte dans ses décisions économiques. Ce n’est pas le choix retenu par CARE.
Ses initiateurs refusent de considérer le capital naturel et le capital humain comme des coûts, parce qu’ils sont tout autant que le capital financier des contributeurs indispensables à la création de valeur. CARE identifie donc trois types de capital, le capital financier apporté par les investisseurs sous forme de fonds propres ou de dette financière, le capital naturel qui comprend les ressources non renouvelables et les ressources environnementales (la qualité de l’air est une telle ressource) et le capital humain qui est la communauté de travail qui aide au sens large à la production de l’entreprise.
En bonne comptabilité, le capital financier est pris en compte au passif du bilan, en tant qu’apporteur de ressources qu’on retrouve immobilisées sous forme de biens matériels et immatériels à l’actif du bilan. Les deux auteurs cités considèrent à juste titre qu’il ne faut pas assimiler le capital aux biens immobilisés ou courants qu’il opère. E et S doivent donc, dans cette approche holistique, figurer également au passif d’un bilan élargi. L’exploitation de la carrière de granulats ne doit plus être prise en compte uniquement par les coûts financiers que son usage ou son titre de propriété engendrent. On doit se placer en quelque sorte du point de vue de la nature et considérer à la fois son apport à la production, c’est-à-dire le revenu qu’elle aide à engendrer, et le coût qu’elle subit à rendre ce service. S’il y a eu dégradation de la nature, le coût subi sera la restauration à accomplir pour retrouver le capital nature initial. Même chose pour le capital humain : des conditions de travail trop dures affectent la santé des employés et donc « dégradent » le capital humain qui est une ressource au passif de l’entreprise. (Notez la différence : le planteur de Virginie du 18e siècle mettait ses « esclaves » à l’actif de son bilan parce qu’il s’en disait propriétaire.) Le concept de fonction de production des économistes adopte le même traitement : le capital humain est bien un facteur de production, de même, plus récemment, que le capital constitué par les ressources non renouvelables.
Avec cette simple idée en tête, on met le doigt sur le traitement aujourd’hui dissymétrique du capital financier d’une part et des deux autres formes de capital de l’autre. Le premier, assimilé improprement aux actifs économiques de l’entreprise, est considéré dans une optique de continuité de l’entreprise, ce qui conduit à prendre en compte un « amortissement » (ou une « réserve » pour retenir le meilleur mot de l’anglais), c’est-à-dire le montant de dépenses à prévoir pour en maintenir la capacité productive. Dans la logique de CARE, il convient de faire exactement pareil pour les deux autres types de capital. D’où la notion de soutenabilité ou de durabilité qui sont devenus des mots importants dans une perspective ESG. Dans son usage des ressources naturelles, l’entreprise met de côté ce qui peut préserver l’intégrité de la nature. Dans le cas contraire, elle a usé d’un service rendu par la nature sans restituer ce qu’elle a pris. Il s’agit, dans le langage de CARE, d’une dette vis-à-vis de la nature, sans jamais la rembourser. Les générations humaines futures en assumeront les conséquences. Sans trop abuser de la notion, il va de même si la génération présente, celle qui est au travail, subit un dommage : ses descendants proches la subiront aussi, même si, comme le mot l’indique, les générations se régénèrent sans limite.
Les deux étapes de la méthode
a. L’identification des cibles et la collecte des données
Cette étape est essentielle. Elle est guidée, à des fins de mesure, par le principe de préservation. On s’attache à définir les possibles impacts de l’entreprise sur l’environnement, vu dans une optique de soutenabilité. Les initiateurs de CARE en ont une vision très étroite : il s’agit bien de restaurer les capitaux naturel et humain dans leur état antérieur. On refuse l’idée d’une compensation par laquelle un surplus de capital financier viendrait en dédommagement des dégâts que l’activité aura générés (ceci même en supposant qu’il n’y a pas de gâchis de ressources, l’entreprise étant supposé gérée de façon optimale).
Si on prend l’exemple de la carrière de granulats, l’entreprise doit prendre en compte le coût de restauration à l’identique du lieu utilisé au terme de l’exploitation. Le terme « à l’identique » pose question, mais renvoyons cela à la discussion qui suit. S’agissant des accidents du travail, la cible la plus présentable est de les éviter totalement, et le coût associé doit être l’aménagement du lieu de travail pour cette prévention. On imagine inversement qu’un programme de formation du personnel qui accroit leur employabilité dans et hors l’entreprise pourrait être compté positivement comme accroissement du capital humain.
La démarche CARE consiste donc à examiner une par une toutes les interactions de l’entreprise avec son environnement, voir s’il y a externalité, et, si c’est le cas, se donner comme cible la restauration du capital en son état antérieur. On voit ici qu’on est très proches de ce que demande le Rapport de durabilité, dit encore comptabilité extra-financière, qui fait partie des bonnes pratiques ESG et qui, désormais normalisé, va avoir force de loi dès 2025 suite à la directive CRSD votée récemment au niveau européen. À cet égard, CARE a devancé le mouvement, si ce n’est qu’il laisse davantage de liberté à l’entreprise de désigner les points d’impact de son activité sur l’environnement. En revanche, par rapport à CRDS, il va plus loin en proposant un cadre comptable intégré.
b. Le cadre comptable
Le capital financier est parfaitement périmétré, puisqu’il s’agit des fonds mis à disposition de l’entreprise, connus à l’euro près et qu’on peut éventuellement mesurer à leur valeur financière présente (les auteurs, très réticents sur la notion de prix de marché en comptabilité et attachés aux coûts historiques, s’y refusent). Les capitaux E et S par contre ont des limites « floues » quand il s’agit de les mesurer. On ne connaît pas, par exemple, les stocks naturels de cuivre ou de granulats qui existent naturellement au niveau mondial et a fortiori les droits qu’un pays ou une entreprise ont sur ce stock.
Face à cette limitation, les initiateurs de CARE retiennent astucieusement la convention suivante. Sera considéré comme capital intervenant au passif du bilan élargi, qu’il soit E ou S, le montant identifiable de ressources à mobiliser pour restaurer « à l’identique » ce capital. Il s’agit alors d’une dette à l’endroit de la nature ou du facteur humain, c’est-à-dire ce que l’entreprise a « emprunté » à la nature et aux hommes pour son activité. Cela reste « flou » bien évidemment : on est bien en peine de définir précisément ce que signifie la préservation de la carrière de granulats puisque le lieu ne sera jamais rendu à l’identique de ce qu’aurait été la parcelle s’il n’y avait pas eu l’extraction de granulats, sans compter le fait que les granulats sont partis à jamais. Comme on va le voir, cette question relève profondément de ce qu’on entend par soutenabilité.
Si l’on ouvre une entrée comptable au passif, on doit l’équilibrer par un poste de l’actif. On inscrit donc une sorte de « droit d’usage » des capitaux E et S à l’actif. (Notez, pour les lecteurs connaissant la comptabilité, la similitude avec ce que préconise IFRS 16 pour le leasing opérationnel, y compris la location immobilière : on met une dette au passif qui est la somme des loyers à venir et un droit d’usage à l’actif.) Les efforts que fait l’entreprise pour atténuer, réparer ou préserver E et S seront pris en compte comme on le fait de l’amortissement pour le capital financier : ils réduisent à la fois le droit d’usage et la dette E ou S au passif. Au-delà d’un amortissement forfaitaire, de réserve, toute dépense de restauration effective de ces capitaux vient également réduire la dette enregistrée au passif (jusqu’à parfois représenter une créance ?).
Ainsi, calculant son résultat net de ces coûts de préservation de E et de S, l’entreprise est capable de montrer dans ses comptes sa véritable contribution sociale.
Commentaires
On énonce ici quelques rapides considérations critiques sur le modèle.
- L’approche des capitaux environnementaux par les dépenses force l’entreprise à imaginer constamment ce qu’elle peut entreprendre pour la préservation. C’est un effort fécond. Mais la « liste de courses » s’accroît sans cesse car il faut toujours imaginer la façon dont on va chiffrer telle ou telle mesure de préservation. Que l’on pense au chiffrage du maintien de la diversité biologique. Dans CARE, les capitaux E et S se régénèrent dès qu’on arrive à faire rentrer dans des chiffres le dommage qu’on leur fait. Mais le prix à payer est par force une certaine instabilité des comptes publiés à cause des constants changements de périmètre et de méthodologie de calcul, qui au demeurant peuvent différer d’une entreprise à l’autre. Cela reste aujourd’hui une limitation sérieuse à la méthode. Restant plus « qualitatif », le Rapport de durabilité de la CRDS semble plus réaliste bien qu’il soit déjà extrêmement exigeant.
- Le traitement des trois types de capital n’est pas homogène et choque l’intuition. Cela tient à l’hypothèse faite de retenir comme mesure de E et S le montant de dépenses destiné à en restaurer l’usage premier. L’objectif de l’entreprise est en effet de maximiser le capital financier, alors qu’elle cherche au contraire à réduire à zéro les deux autres. Voici que la nature et le capital humain cessent de « contribuer » dès qu’on s’est acquitté des mesures de restauration. Notez qu’il y a une dissymétrie de même nature au sein même du capital financier, puisqu’une partie des apporteurs de capital, les porteurs de dette, voient la charge d’intérêts, à savoir leur rémunération, considérée comme un coût du point de vue de l’entreprise. Les auteurs de CARE ont une vision, certes consacrée par la comptabilité classique, de privilège donné aux capitaux apportés par les actionnaires, négligeant le rôle important joué par la dette financière.
- La notion de capital humain vu du simple point de vue des dépenses pour sa préservation est sérieusement limitative. C’est patent sur l’exemple citée par eux des salaires anormalement bas. On imagine mal que l’entreprise adoptant CARE et payant des salaires « indécents » reconnaisse leur indécence en inscrivant un capital humain à son bilan. Mais le point conceptuel est que la référence pour juger de l’indécence est nécessairement le salaire normal de marché dans des bonnes conditions de concurrence. La notion de dommage se rattache alors à l’écart à un prix concurrentiel de marché. On n’échappe pas ici à la référence de marché.
- Pourquoi, outre le capital naturel, se limiter au capital humain ? Pourquoi ne pas compter comme dommage des prix indécents payés à ses fournisseurs ? Ou le surprofit qu’elle fait sur le dos de ses clients quand elle a la possibilité de leur tordre le bras ? Dans une logique CARE correctement suivie, on devrait inclure d’autres types de capitaux, dont le « capital clients » et le « capital fournisseurs ». La méthode CARE finit par se dissoudre, traitement comptable en plus, dans une approche de l’entreprise du point de vue des parties prenantes (stakeholder capitalism). Une telle tentative serait conceptuellement mieux assise en introduisant la notion de « valeur sociale » (voir ici dans Vox-Fi).
- La notion de soutenabilité retenue par CARE pose question. Pour les initiateurs du modèle, il s’agit d’une soutenabilité dit forte, qui cherche à restituer le capital tel qu’il était avant son usage. Mais cette cible est souvent hors d’atteinte : les granulats extraits ne reviendront jamais à leur place ; la formation que n’a pas reçue le personnel est largement irrattrapable. Il est préférable d’admettre une certaine dose de substituabilité entre les trois types de capitaux : on compensera tel dommage au capital humain par une compensation financière, à la nature par telle innovation, ce qui en facilite le chiffrage. Cet optimisme dans les choix techniques ou dans les méthodes de réparation est une nécessité. À défaut, l’usage régulier d’une ressource non renouvelable qui serait non substituable stopperait un jour ou l’autre la machine économique. Si le cuivre devait être à la fois incontournable et non substituable techniquement, tout s’arrêterait le jour où ses stocks seraient épuisés. Le choix se limiterait à une vie heureuse mais courte et une vie longue mais malheureuse. D’où la préférence donnée en écologie à une soutenabilité faible, celle qui assure le même type de vie à l’espèce humaine ou – plus ambitieux mais à mon sens nécessaire – à l’ensemble du vivant.
- Les concepteurs de CARE s’en tiennent mordicus au principe du coût historique pour la comptabilité environnementale. On en comprend mal le motif. Même en comptabilité financière traditionnelle, on est obligés d’en venir au prix de marché courant si l’on veut par exemple calculer une provision ou un engagement futur incertain. Il faut de même réévaluer le coût de préservation d’une ressource si on estime qu’il va s’accroître dans le futur. Souvent, comme on l’a vu dans les cas des salaires, c’est le prix d’un marché sans effet de domination qu’on prend comme référence. On le voit plus précisément s’agissant des émissions de gaz à effet de serre (en équivalents tonne de carbone). L’objectif de l’entreprise s’il s’agit de préservation stricte est d’être à terme net zéro. Pour certaines activités, l’objectif est pratiquement inatteignable, le coût de préservation devenant alors infini pour elle. Des approches alternatives existent : compter simplement les carbones sous forme physique et laisser l’entreprise en faire le suivi en unités physiques dans une optique de réduction ciblée (voir ici dans Vox-Fi la proposition de comptabilité carbone généralisée) ; ou bien retenir un prix notionnel du carbone et l’intégrer dans ses coûts pour calculer une marge décarbonée. Si on doit retenir un prix du carbone, le mieux serait bien sûr qu’il le soit sous la forme d’une taxe ou d’un coût occasionnant une sortie de cash. Ainsi, l’entreprise ferait mieux que de calculer sa marge décarbonée ; elle modifierait par force sa politique de prix, d’achat et d’investissement pour optimiser sa rentabilité monétaire.
La méthode CARE a préfiguré ce qu’est à présent la comptabilité extra-comptable et le Rapport de durabilité, un effort qui va requérir un montant important de ressources de l’entreprise pour le faire de façon fiable. Elle présente plus de souplesse par rapport aux exigences très fortes de la CRDS, mais le fait au risque d’un flou dans les méthodes d’évaluation, dans le périmètre des dommages environnementaux et dans les concepts utilisés. Cela rend pour le moins prématuré l’objectif de faire rentrer ces données dans un cadre comptable unifié.